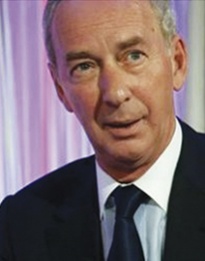Cet article a été écrit par Jean-Dominique Giuliani, il est issu du n°55 des Cahiers de la sécurité et de la justice.
Face au risque de nouvelles crises d’ordre sanitaire, économique, énergétique, climatique, militaire ou cybercriminel, l’Union européenne doit agir pour accroître sa résilience. Dans un contexte d’accroissement des rivalités stratégiques, comment faire progresser l’Europe souveraine pour répondre aux enjeux sécuritaires des années à venir ?
Si la sécurité est avant tout une compétence nationale, force est de constater que les coopérations policière et judiciaire à l’échelle européenne se multiplient. Depuis la mise en place de l’espace Schengen, l’Union européenne s’efforce de renforcer la sécurité de nos frontières extérieures et garantir la liberté de mouvement des Européens.
Cependant, face à l’émergence de nouvelles menaces, l’Union s’efforce de développer de nouvelles capacités d’action en recherchant des solutions pérennes à des évolutions structurelles. La pandémie a démontré notre capacité à agir vite lorsque les événements l’imposent. Nous devons désormais renforcer notre autonomie industrielle et technologique dans une perspective de plus long terme.
Les valeurs que promeut l’Union européenne sont aujourd’hui défiées à travers le monde. De nouveaux acteurs revendiquent leur politique de puissance. La diffusion par la marine de Pékin d’une vidéo de l’un de ses exercices militaires montrant les troupes de la République populaire s’entraîner à débarquer sur des « plages ennemies » en témoigne. Les États concurrents n’hésitent pas à s’affranchir du droit international. Ces pratiques remettent en cause la sécurité de l’Europe. En 2021, les dépenses militaires de la Chine étaient 10 fois supérieures à celles de 1994, et représentaient 14 % des dépenses militaires mondiales. Lors de la session annuelle de l’Assemblée nationale populaire, le parti communiste chinois (PCC) a annoncé que le montant du budget militaire de la Chine s’élevait en 2021 à plus de 200 milliards de dollars, soit le deuxième budget militaire derrière celui des États-Unis et presque l’équivalent de toutes les dépenses militaires des pays européens. À l’instar de la Chine, les États-Unis, la Russie, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud ou encore l’Australie ont augmenté leurs dépenses militaires au cours de la décennie 2011-2020.
De plus en plus, les investissements dans des applications militaires à des technologies spatiales prennent une part grandissante dans les budgets de défense des États. Devant l’émergence de l’espace spatial comme un terrain de compétition stratégique pour la maîtrise des données numériques, les Européens doivent renforcer leur autonomie pour garantir leur propre sécurité. Beaucoup de ces enjeux seront portés par la présidence française du Conseil de l’Union européenne au premier semestre 2022 qui devra ratifier l’élaboration d’une vision stratégique commune.
Le même constat s’impose en ce qui concerne l’espace maritime. Nous devons accroître nos capacités d’action. Les tentatives chinoises de territorialisation de la mer constituent une menace à la liberté de navigation. Il ne faut pas avoir peur de dire qu’il est nécessaire de développer une puissance militaire européenne. Il ne s’agit pas de faire la guerre mais de préserver la paix. Au cours de l’année 2020, les dépenses militaires des États membres de l’Union européenne ont augmenté de 4 % témoignant d’une prise de conscience des évolutions géopolitiques 1. Faire du développement de la sécurité un enjeu européen suppose de prendre en compte les différentes perceptions des États membres et de définir des enjeux prioritaires communs.
La « boussole stratégique », qui sera adoptée sous présidence française en mars 2022, est une stratégie globale qui répond à la volonté de définir les menaces communes auxquelles sont exposés les États membres et d’analyser les moyens à déployer pour y faire face. Il s’agit de répondre aux questions suivantes : « À quelles menaces et vulnérabilités sommes-nous exposés ? Quels objectifs nous donnons-nous pour y répondre ? Quels sont par conséquent les moyens nécessaires à employer pour les surmonter ? ».
La sécurité concerne de nombreux domaines d’action. L’Union européenne est aujourd’hui confrontée à plusieurs défis dont l’acuité est renforcée par les évolutions technologiques. L’Europe doit démontrer sa capacité à agir. C’est par le développement d’une capacité commune d’action que nous pourrons assurer la défense de nos intérêts et la sécurité des Européens.
Approfondir la coopération policière à l'échelle européenne : agir face au développement d'une criminalité transfrontalière
Les progrès en matière de renforcement de la coopération policière à l’échelle de l’Union européenne sont souvent méconnus. La lutte contre la criminalité est pourtant devenue une préoccupation majeure de l’Union européenne à partir de l’élaboration du troisième pilier « Justice-Affaires intérieures » au cours des années 1990. En effet, la mise en œuvre du marché unique avec la suppression des contrôles aux frontières intérieures posait le problème des conséquences de la libre circulation des personnes et des biens.
La criminalité transnationale organisée (CTO) est identifiée comme une menace majeure pour les citoyens, les entreprises et les institutions européennes. Les recettes d’origines criminelles représentent en 2019 1 % du PIB européen soit environ 139 milliards d’euros 2. Ce chiffre est sous-évalué puisqu’il s’agit uniquement des actes connus. La diversité des actes criminels perpétrés (trafic de migrants, trafic d’organes ou traite des êtres humains…) ainsi que leur caractère diffus dans l’espace rendent d’autant plus difficile leur détection. À cet égard, Europol (agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité) a identifié 5 000 criminels dont 70 % opèrent dans au moins trois États membres.
Tous les quatre ans, l’Union européenne fixe par l’intermédiaire d’Europol des programmes pour lutter contre la criminalité transnationale organisée. Le programme actuel pour la période 2018-2021 établit 10 priorités parmi lesquelles la lutte contre la traite d’êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants. Grâce aux efforts conjoints d’Europol et d’Eurojust, 94 groupes criminels qui pratiquaient la traite d’êtres humains ont été identifiés ou démantelés en 2019 3. Une victime sur quatre (22 %) de la traite des êtres humains est un enfant. Pour lutter efficacement contre cette forme de criminalité à caractère transnational, la réponse européenne est pertinente. L’Union européenne doit intensifier sa coopération avec les États membres. La nature des menaces le lui impose.
À travers ses 1 323 agents, Europol apporte aux États membres un soutien opérationnel qui se matérialise par le regroupement de données et la production d’expertises. Depuis 2016, le rôle d’Europol dans la lutte contre le terrorisme a, par ailleurs, été renforcé. Elle dispose désormais d’un mandat élargi notamment en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen. La coopération européenne s’approfondit.
Pour renforcer la coopération judiciaire entre les États membres, Eurojust a été créée en 2002. Elle constitue le pendant juridique d’Europol et vise à transposer les enquêtes judiciaires nationales au niveau européen, facilitant ainsi la coopération entre les États membres. Plus largement, son rôle vise à promouvoir, améliorer et soutenir la coopération judiciaire entre les États membres. En parallèle, l’instauration du mandat européen depuis 2004 a permis de faciliter l’arrestation des criminels en dehors de leur État d’origine sur le territoire européen. À titre d’exemple, en 2018, 17 471 mandats ont été ainsi publiés dans les 27 États membres et 7 000 personnes ont fait l’objet d’une remise transfrontalière. Une culture judiciaire européenne commune, fondée sur l’État de droit et les droits fondamentaux, est en train de naître, sur la base de davantage de confiance mutuelle.
La sécurité des frontières extérieures de l'Union européenne : une condition de la stabilité du continent
La libre circulation au sein de l’espace Schengen suppose un renforcement des frontières extérieures de l’Union pour garantir la sécurité des Européens.
Depuis le 1er janvier 2021, et suite à l’adoption d’un nouveau règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), par le Conseil de l’Union européenne, un contingent permanent de garde-frontières devant atteindre 10 000 agents d’ici 2027 est progressivement déployé afin de renforcer la sécurité des frontières de l’Europe. En 2019, les services répressifs de l’Union ont ainsi saisi plus de 11 000 armes à feu 4. L’Union européenne estime à 35 millions le nombre d’armes à feu illicites détenues par des civils au sein de l’Union européenne en 2017. Dans le cadre de la lutte contre la circulation d’armes illégales, l’Union développe des accords de partenariats avec les Balkans, les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient 5. Concernant la lutte contre le trafic de drogue, 1,1 million de saisies de drogues illicites pour un montant d’environ 30 milliards d’euros 6 ont été réalisées par l’Union en 2019. Parce que 70 % des frontières extérieures de l’Union européenne sont maritimes, l’Union doit accroître la surveillance des principaux ports utilisés comme plaques tournantes pour le trafic de drogue. La coopération européenne et internationale dans le domaine du trafic maritime reste essentielle pour améliorer les capacités de renseignement et d’action des États membres.
La politique de protection des frontières de l’Union européenne vise à empêcher l’entrée dans le territoire européen d’armes ou de substances illégales. Elle vise également à régulariser les mouvements des personnes entre les frontières. En ce sens, la migration constitue un enjeu majeur.
La politique migratoire européenne repose sur un dialogue permanent entre les États voisins et l’Union européenne afin de lutter contre les mouvements irréguliers de personnes et la traite des êtres humains. Selon les données publiées par l’Agence en 2020, Frontex a sauvé 13 170 personnes d’une noyade en mer, a arrêté 742 passeurs de migrants irréguliers et éloigné des frontières extérieures 12 000 personnes qui ne disposaient pas de droit d’entrée sur le sol européen 7. La sécurisation des frontières extérieures de l’Union vise à contrôler la régularité de la situation des ressortissants de pays tiers. Au cours des dernières années, certains gouvernements dans le voisinage de l’Union européenne ont utilisé les migrations comme un outil de pression diplomatique. Pour mettre un terme à cette pratique, l’Union a durci sa politique de sanctions à l’égard du régime biélorusse. L’organisation d’une filière de transfert de migrants en provenance de Beyrouth ou de Damas via Minsk par le régime d’Alexandre Loukachenko ne pouvait pas être tolérée et l’Union a su faire preuve d’une fermeté peu coutumière. Par cette action cynique, la Biélorussie et la Russie, en accentuant la pression sur les frontières polonaises et lituaniennes se livraient à une forme de « guerre hybride 8 » contre une Union européenne qui les inquiète et les dérange. En mars 2020, le président turc Recep Tayyip Erdogan a tenté lui aussi d’utiliser la menace, en annonçant qu’il laisserait les migrants rejoindre l’Europe jusqu’à ce qu’il obtienne une réponse de l’Union européenne à ses exigences. Face à ce genre d’actions qui visent à remettre en cause la stabilité du continent, l’Union a joué simultanément de divers canaux. La chancelière allemande a su négocier avec les dictateurs les sorties de crise nécessaires tandis que l’Union, moins exposée, faisait preuve de fermeté.
La souveraineté industrielle et technologique européenne : développer notre autonomie pour accroître notre liberté d'action
La crise de Covid-19 a révélé la nécessité d’accroître l’autonomie industrielle de l’Union européenne. La pénurie de masques, de respirateurs, de blouses, puis de tests et les difficultés à reconvertir les industries vers la production de ces biens ont mis au jour les conséquences néfastes de la désindustrialisation, des délocalisations et les limites à l’établissement de chaînes de valeur étendues. À cet égard, la pandémie de Covid-19 a suscité une prise de conscience quant à la nécessité de réduire les dépendances stratégiques vis-à-vis de pays tiers. Le développement de la souveraineté industrielle doit permettre à l’Union européenne de fournir les technologies qu’elle juge critiques pour les populations et pour la compétitivité de son économie. Plus particulièrement, les domaines de la santé, des infrastructures de communications, du numérique, et tout ce qui a trait aux activités régaliennes et aux services publics constituent des enjeux prioritaires de renforcement de son autonomie.
À cet égard, le constat d’une trop grande dépendance européenne vis-à-vis de la Chine et de l’Inde en matière de production de principes actifs pharmaceutiques a incité l’Union européenne et les États membres à esquisser le projet d’une Europe de la santé. Plus précisément, le programme EU4 Health vise à l’achat et la gestion mutualisée de stocks de précaution et la constitution d’équipes mobiles d’intervention mobilisables en cas de crise interne dans un des États membres. L’Union a montré qu’elle était capable d’agir vite et d’une manière unie. Par ailleurs, la Commission européenne a dévoilé les contours d’une BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) européenne dotée d’1 milliard d’euros par an. Baptisée HERA (Health Emergency Response Authority), l’autorité qui devrait être opérationnelle durant le premier semestre de l’année 2022 sera, elle, chargée d’anticiper les menaces et les crises sanitaires potentielles grâce au renforcement des capacités de réaction nécessaires au stockage et à la distribution des médicaments et du matériel médical.
Par ailleurs, afin de devenir plus autonomes dans des secteurs stratégiques d’avenir, nous devons investir dans le domaine de l’énergie et notamment dans le développement de batteries à hydrogène vert 9. Afin d’inciter les entreprises européennes à relocaliser une partie de leur production sur le territoire européen, l’Union européenne souhaite utiliser sa politique commerciale pour dessiner un cadre juridique et politique propice aux investissements dans l’industrie européenne 10. Notre économie doit susciter de l’enthousiasme. Elle a les moyens humains et les capacités technologiques pour réaliser de grands projets. Par exemple, le projet ITER, qui doit démontrer que la fusion peut être utilisée comme source d’énergie décarbonée pour produire de l’électricité figure parmi les plus ambitieux du monde 11. À cet égard, dans le cadre du plan de relance NextGenerationEU, la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont présenté le programme InvestEU, dont l’objectif est de lever 372 milliards d’euros sur la période 2021-2027. Ce plan vise à permettre le renforcement de l’autonomie stratégique européenne en ce qui concerne l’ensemble des technologies et chaînes de valeurs clés, tout en participant à la mise en œuvre des transitions écologique et numérique 12. Grâce à InvestEU, des banques et institutions financières autres que la BEI pourraient ainsi bénéficier directement d’une garantie budgétaire, permettant une décentralisation de la procédure et un soutien des projets au plus près du terrain.
L’approfondissement de la souveraineté stratégique de l’Union européenne ne vise pas une autarcie absolue. L’ouverture au commerce avec des partenaires extérieurs et aux investissements reste une source de croissance pour l’Union, qui est un importateur et un exportateur de premier plan. Le modèle européen d’autonomie stratégique vise à ce que l’Union maintienne son ouverture à la coopération internationale chaque fois qu’elle le peut tout en se protégeant des pratiques déloyales, y compris en prenant des mesures autonomes chaque fois que cela est nécessaire. Parce que tous les biens nécessaires à la croissance de son économie ne peuvent pas être produits sur son territoire, l’Union européenne doit renforcer ses accords commerciaux avec ses partenaires de confiance afin d’assurer une sécurisation de ses approvisionnements.
La sécurité numérique : renforcer la maîtrise de l'utilisation de nos données
Au-delà de la mise en lumière du caractère stratégique que revêt la sécurisation de l’approvisionnement de biens essentiels, la crise de Covid-19 a également révélé le rôle central des outils numériques. En fournissant aux Européens les moyens de travailler à domicile, de recevoir des livraisons, de suivre des cours à distance, d’utiliser des paiements en ligne, les outils numériques ont permis aux économies européennes de s’adapter à des circonstances inédites. À cet égard, si l’Union européenne se distingue sur la scène internationale par son encadrement légal du numérique, elle reste une « colonie du monde numérique 13 » sur le plan industriel, au regard de sa dépendance dans certaines technologies structurantes (grandes plateformes, cloud, semi-conducteurs, etc.).
Par ailleurs, l’utilisation croissante du télétravail et le transfert de données vers des plateformes numériques ont accru la vulnérabilité des infrastructures aux cyberattaques. Déjà en 2019, lors de son élaboration, le programme stratégique de l’Union européenne pour la période 2019-2024 14 insistait sur la nécessité de placer au cœur de l’action de l’Union, l’établissement d’une réponse coordonnée aux cyberattaques. Cette tendance à la généralisation du numérique et donc à l’essor du nombre de cibles potentielles devrait continuer de croître dans la mesure où il est estimé que « 22,3 milliards d’appareils dans le monde devraient être connectés à Internet d’ici à 2024 15 ». Les secteurs des transports, de l’énergie, de la santé ou encore de la finance qui dépendent de l’utilisation des technologies numériques pour mener leurs activités représentent ainsi autant de cibles potentielles pour les cyberattaques. À titre d’exemple, la cyberattaque contre le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône dans le Rhône, le 17 février 2021 a eu pour conséquence d’empêcher l’accès aux dossiers médicaux des patients et a imposé le report d’interventions chirurgicales. De même, la cyberattaque contre la société américaine Kaseya en juillet 2021 a provoqué la fermeture de plus de 600 supermarchés suédois. Il est donc impératif que nous renforcions la sécurité de nos outils numériques.
De ce point de vue, la crise sanitaire a accéléré la prise de conscience de la nécessité de faire évoluer l’Europe de puissance régulatrice à créatrice de normes mais aussi de produits. Au-delà du besoin de réduire les dépendances industrielles européennes, la crise de Covid-19 a mis au jour le caractère stratégique du renforcement de l’autonomie numérique européenne.
Pour répondre aux enjeux sécuritaires du numérique, le Conseil de l’Union européenne a adopté le 22 mars 2021, une nouvelle stratégie de cybersécurité pour l’Union 16 visant à renforcer les capacités d’anticipation et de réponse de l’Europe aux cybermenaces. Plus particulièrement, il s’agit derrière cette nouvelle stratégie numérique européenne de mettre en place un réseau de centres des opérations de sécurité dans toute l’Union afin de prévenir les signes d’attaques sur les réseaux et d’établir des réponses coordonnées en matière de cybersécurité. La Commission a également proposé la création d’une unité conjointe de cybersécurité 17, adoptée par le Conseil européen le 19 octobre 2021. Ursula von der Leyen a annoncé vouloir faire de cette unité conjointe un outil de regroupement des expertises et des ressources des États membres de l’Union européenne. Il s’agit plus particulièrement de faire collaborer les différents acteurs de la cybersécurité que constituent les communautés civiles, diplomatiques, et militaires avec des acteurs du secteur privé. L’ENISA (Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information) travaille ainsi en étroite collaboration avec Europol afin de venir en appui aux États membres en mettant à leur disposition son expertise dans la lutte contre les menaces cybercriminelles. L’unité conjointe de cybersécurité vise à permettre aux différents acteurs de la cybersécurité de partager en temps réel les informations dont ils disposent ainsi que les meilleures pratiques à adopter afin de se prémunir d’une attaque d’ampleur. La Commission prévoit ainsi une mise en place effective de l’unité conjointe de cybersécurité au plus tard d’ici le 30 juin 2023.
La Commission a érigé le numérique comme l’un de ses quatorze « écosystèmes industriels » prioritaires et a doté en avril 2021 son programme pour une Europe numérique (2021-2027) d’un budget de 7,6 milliards d’euros. Il s’agit d’accroître les investissements en faveur de quatre priorités : le calcul à haute performance, l’intelligence artificielle, les compétences numériques avancées et la cybersécurité.
Le secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, a déclaré que le numérique serait érigé comme un enjeu prioritaire de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. La dimension européenne s’impose en effet naturellement pour organiser la coopération numérique des États membres, même si la compétence nationale reste longtemps encore la règle en ce domaine. L’Union européenne est un acteur incontournable en matière de normes et de standards de cybersécurité. Elle est de surcroît gardienne des valeurs de démocratie, d’État de droit, de droits de l’Homme et aide à sauvegarder les libertés fondamentales dans un domaine où la confidentialité, voire le secret, contraint souvent les États à agir seuls sur le plan national.
L'enjeu de la maîtrise du domaine spatial : espace d'incarnation de la puissance
L’Europe de l’espace tente de se renforcer. Si la conquête spatiale constitue un enjeu de puissance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’essor des technologies numériques a permis aux acteurs étatiques et privés de porter de nouvelles ambitions dans ce domaine. La course à la maîtrise de l’espace connaît une accélération. Elle revêt une importance économique évidente, mais aussi de plus en plus d’un point de vue sécuritaire. En effet, les services et les applications qui utilisent des données transitant par l’espace occupent désormais une part centrale de l’activité quotidienne des États, des entreprises et des personnes.
Aujourd’hui, la course stratégique vers l’espace n’est plus limitée à un nombre restreint d’États. L’Inde et l’Israël disposent désormais de capacités de lancement. Les États-Unis, la Russie et la Chine déploient des applications militaires aux technologies spatiales de défense. Le 15 novembre 2021, un missile tiré par Moscou sur l’un de ses satellites a provoqué un champ de débris orbitaux qui a mis en danger la sécurité de la Station spatiale internationale et ses sept astronautes. L’incident a relancé les craintes de voir l’espace se transformer en un champ de bataille. Pour la première fois, Moscou a « démontré sa capacité à frapper un satellite à l’aide d’un missile lancé depuis la Terre 18 ».
L’Union européenne a, elle aussi, rénové sa politique spatiale afin d’accroître son autonomie en ce domaine. Elle pilote aujourd’hui un ambitieux programme spatial qui comprend notamment Copernicus et Galileo-Egnos. Copernicus est un programme de surveillance de l’environnement pensé en 1998 par un groupe de chercheurs préoccupés par l’évolution de la Terre. L’objectif initial était de mutualiser toutes les ressources disponibles au niveau européen afin de créer des services de surveillance de l’environnement. Aujourd’hui, le programme Copernicus 2.0 couvre six domaines d’action : la qualité de l’air, le changement climatique, l’environnement marin, le territoire, l’intervention d’urgence, et enfin la sécurité. Au regard de ses compétences en matière de sécurité, le service Copernicus vise à soutenir les politiques de l’Union européenne en fournissant des informations en matière de surveillance des frontières et de surveillance maritime. Plus particulièrement, Copernicus apporte un soutien à l’action extérieure de l’Union européenne en fournissant des informations sur des zones éloignées, difficiles d’accès, où des questions de sécurité sont en jeu et où l’intervention de l’Union est nécessaire 19. Quant à Galileo, il est le système de positionnement par satellite le plus précis sur le marché. On ne sait pas en Europe qu’il équipe et nourrit plus d’un milliard d’utilisateurs dont désormais tous les smartphones produits récemment. Il permet en outre des usages militaires et gouvernementaux qui ne cessent de se développer.
En avril 2021, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont adopté un règlement établissant le nouveau programme spatial européen pour la période 2021-2027 20. Le budget en hausse, s’élevant à 14 milliards d’euros sert les ambitions suivantes : garantir l’autonomie et la sécurité de l’Europe en matière d’accès à l’espace, stimuler la croissance de l’économie spatiale européenne, et faire des découvertes décisives pour la connaissance de la Terre, du Système solaire et de l’univers afin d’intensifier les efforts entrepris pour protéger la planète. Le programme entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 vise à garantir des données et services spatiaux sécurisés ainsi qu’un renforcement de l’autonomie de l’Union. Plus largement, il s’agit de permettre à l’Union européenne de conserver son rang parmi les acteurs de premier plan dans le secteur spatial. Le programme introduit également de nouvelles composantes en matière de sécurité, telles que le programme « surveillance de l’espace » (SSA) ou la nouvelle initiative de télécommunications gouvernementales par satellite (Govsatcom) qui a pour but de fournir aux autorités nationales un accès à des télécommunications par des satellites Galileo sécurisées 21. Ces innovations doivent nous permettre d’assurer la protection de nos données et de nos infrastructures. C’est une nécessité.
Même si l’accroissement du nombre de satellites en orbite devait conduire à une augmentation de leur utilisation dans le cadre des transferts de données, il n’en demeure pas moins qu’à l’heure actuelle, près de 99 % du trafic total sur Internet et des télécommunications mondiales sont assurés par les câbles sous-marins. Il en existe en effet plus de 420 dans le monde, totalisant 1,3 million de kilomètres, soit plus de trois fois la distance de la terre à la lune 22. La sécurisation des câbles sous-marins constitue donc un enjeu stratégique pour une indépendance numérique européenne.
Par ailleurs, dans le cadre du programme Horizon Europe, la mission Starfish 2030 vise à modéliser l’ensemble des mers et océans afin de mieux en comprendre les mécanismes et interactions 23. La création de ce jumeau numérique de l’océan est rendue possible par le programme Copernicus 24 qui assure l’observation de la Terre par l’utilisation de satellites. Parce que les mers et océans se situent au cœur de différents enjeux : climatique, économique, social, démographique… l’Europe à l’opportunité de devenir une véritable puissance bleue.
Le renforcement de la sécurité maritime : l'enjeu du développement de la puissance bleue
Le domaine maritime fait l’objet d’une compétition stratégique au même titre que l’espace et le cyberespace. Les enjeux sécuritaires et environnementaux liés aux océans, aux mers et aux littoraux impliquent donc de développer une politique maritime commune. En effet, 22 des 27 pays de l’Union européenne ont un littoral maritime qui s’étend sur plus de 75 000 km bordant 2 océans et 4 mers. La Zone économique exclusive (ZEE) de l’Union européenne est la plus étendue au monde avec une présence sur l’ensemble des mers du globe. L’Europe a donc les moyens de devenir une puissance maritime mondiale. Elle doit trouver dans l’utilisation de sa ZEE les moyens d’être une puissance motrice du XXIe siècle.
Désormais, 90 % des biens échangés dans le monde le sont par voie maritime. La mondialisation a largement contribué à l’accroissement du volume des flux maritimes. En vingt ans, le volume de tonnes transportées via des voies maritimes a doublé, atteignant 9 milliards de tonnes en 2016. Cette dépendance croissante aux voies maritimes est génératrice de vulnérabilités. À titre d’exemple, le blocage du canal de Suez pendant 6 jours au cours du mois mars 2021 avait provoqué l’interruption de la navigation de 422 navires, chargés de 26 millions de tonnes de marchandises 25. Tributaires des importations d’énergie et de matières premières, les économies européennes sont largement dépendantes du transport maritime, de l’activité des ports et de la viabilité des routes stratégiques. 77 % du commerce extérieur de l’Union emprunte la mer et 35 % de son commerce intérieur. La sécurité économique et commerciale de l’Union nécessite donc des infrastructures sûres et sécurisées. À cet égard, la région indopacifique tend à devenir le centre de gravité de l’économie mondiale. Elle constitue un carrefour maritime mondial permettant les échanges vers l’Asie, l’Europe, l’Afrique et le continent américain. Depuis plusieurs années, elle fait l’objet d’une militarisation. Plusieurs espaces en mer de Chine, dans le détroit de Taïwan, le golfe d’Aden, le détroit d’Ormuz et de Malacca suscitent des tensions. Les Européens doivent donc contribuer à prévenir le risque de conflits dans ces zones.
L’Europe en tant que défenseur du droit de la mer et protectrice des océans a un rôle à jouer sur la scène mondiale. L’espace maritime constitue un enjeu de puissance dans la mesure où ses ressources telles que les hydrocarbures, les ressources halieutiques, ou encore les terres rares font l’objet d’une compétition accrue entre les États. On estime ainsi que 80 % des ressources de terres rares seraient au fond des océans 26. Aussi, dans le cadre de la politique de défense européenne, la régulation du domaine marin représente un enjeu clé aussi bien économiquement que du point de vue sécuritaire. L’actualisation du contexte stratégique présentée par la ministre des Armées Florence Parly le 21 janvier 2021 faisait le constat que « les fonds marins deviennent de plus en plus un terrain de rapports de force 27 ». Ils abritent en effet de nombreuses infrastructures comme les câbles sous-marins et des réseaux de distribution d’hydrocarbures 28.
Si les États-Unis restent la première puissance maritime au monde, les forces navales chinoises occupent aujourd’hui le deuxième rang mondial. Employant près de 255 000 marins 29, la marine chinoise a entamé un effort de modernisation. Elle est désormais composée de 350 bateaux et sous-marins. Fondée sur une stratégie de « défense active », la politique de défense de la République populaire continue d’accorder la priorité à la prise de contrôle du domaine maritime qu’elle revendique – Taiwan, la mer de Chine méridionale et les îles Senkaku/Diaoyu 30. Dans le même temps, les États-Unis renforcent leur coopération stratégique avec leurs alliés dans la zone, notamment le Japon et la Corée du Sud, et ils augmentent le nombre d’opérations de liberté de navigation (FONOPs, Freedom of navigation operations 31) en mer de Chine méridionale afin de lutter contre la politique de territorialisation de la mer menée par Pékin. Quelques États membres de l’Union, dont la France, sont régulièrement présents en mer de Chine au nom des mêmes principes et même l’Allemagne a tenté de s’y inviter.
Dans ses conclusions sur une stratégie de l’Union pour la coopération dans la région indopacifique, l’Union européenne promeut une sécurisation des voies de communication maritimes et milite en faveur du renforcement de la présence navale des États membres dans la région indopacifique afin de protéger la liberté de navigation dans la région 32.
Par ailleurs, la Russie de Vladimir Poutine a également exprimé des ambitions navales. La flotte maritime militaire russe a entamé un vaste mouvement de modernisation avec notamment la construction de nouveaux sous-marins et la mise au point de missiles de croisière de nouvelle génération 33. La préoccupation de la flotte militaire russe pour l’Arctique fait écho à la perspective d’ouverture de routes maritimes liée au réchauffement climatique et à la fonte des pôles. À cet égard, le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et de la sécurité commune et la Commission ont présenté le 13 octobre 2021, une nouvelle communication en faveur d’un engagement renforcé de l’Union européenne dans la région arctique. Au regard du changement climatique, des matières premières dont elle recèle ainsi que de l’influence géostratégique qui s’y joue, nous devons y être présents. La région arctique est « d’une importance stratégique majeure pour l’Union européenne 34 ». Il nous faut être présents. Au cours des prochaines années, en raison de la fonte des glaces, la région arctique pourrait devenir le théâtre de possibles tensions, qui seraient susceptibles de menacer les intérêts de l’Union européenne. Dans ce contexte, le développement d’une coordination étroite entre les États membres, avec les autorités régionales et les communautés locales de l’Arctique est requis. L’engagement de l’Union dans les affaires arctiques apparaît désormais comme une nécessité géopolitique. L’Union européenne doit fonder son action sur ses valeurs et ses principes, notamment l’État de droit, les droits de l’Homme, le développement durable, la diversité, le soutien au multilatéralisme et le respect du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM 35).
Par ailleurs, dans le voisinage direct de l’Europe, la Méditerranée demeure une zone de tensions géopolitiques. La Turquie défie le droit maritime international en Méditerranée et utilise la pression migratoire à des fins politiques. Le golfe de Guinée est le théâtre d’activités criminelles qui affectent les flux maritimes commerciaux et contribuent à l’instabilité régionale en faisant obstacle au développement économique de l’Afrique de l’Ouest.
Chacun des États membres a conscience qu’il ne pourrait assumer seul des conflits navals de haute intensité et que les problématiques maritimes dépassent les frontières nationales. À l’échelle européenne, les marines des États membres développent une coopération dans la lutte contre les trafics illicites, la prévention de l’immigration clandestine par voie maritime, ainsi que par EUROMARFOR. Cette force maritime européenne permanente conduite à tour de rôle par l’un des membres (Espagne, France, Italie, Portugal) remplit des missions telles que le contrôle maritime, les missions humanitaires, les missions de maintien de la paix, les opérations de prévention des crises (patrouilles maritimes, guerre des mines) et de rétablissement de la paix 36.
Dans un XXIe siècle qui sera probablement un « siècle maritime 37 » selon les termes du président de la République française Emmanuel Macron lors de son intervention en septembre 2021 aux Assises de la mer, l’Union européenne doit développer ses capacités navales et accroître sa présence sur les mers du globe.
Conclusion
Face aux évolutions géostratégiques et technologiques en cours, l’Union européenne doit repenser son rapport au monde, à l’échelle du monde. Elle doit œuvrer à l’approfondissement de la coopération entre ses membres. Il nous faut définir une stratégie commune autour d’enjeux prioritaires à même de garantir la sécurité des Européens, des valeurs et des intérêts de l’Union. Nous avons les capacités pour agir. La crise de Covid l’a démontré. Face à des concurrents en quête de puissance, l’Union européenne s’efforce de porter l’ambition d’incarner le respect du droit à travers le monde et des valeurs démocratiques. L’Union est née d’une volonté de rétablir la paix. Pour la préserver, elle doit aujourd’hui renforcer son autonomie stratégique face aux nouveaux défis sécuritaires. Force est de reconnaître que si beaucoup reste à faire, les avancées récentes vont toutes dans la même direction : un renforcement de la coopération européenne et l’abandon du simple Soft Power au profit d’un Smart Power plus tangibl.
Notes
(1) https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-04/sipri_milex_press_release_fre.pdf
(2) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1662
(3) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/third-report-progress-made-fight-against-trafficking-human-beings_en (p. 12).
(4) https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-fight-against-crime/
(5) https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:65f0454e-cfef-11ea-adf7-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF (p. 12).
(6) https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/eu-drug-market/
(7) https://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/In_Brief_2020/20.0147_inbrief_2020_11th_web_fixed4.pdf
(8) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5995
(9)
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200706IPR82726/developper-le-stockage-de-l-energie-dans-l-ue-pour-favoriser-la-decarbonation
(10) Bertoncini (Y.), 2020, Relocaliser en France avec l’Europe, étude, Fondapol.
(11) https://www.iter.org/fr/proj/inafewlines
(12) https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/
(13)
Faire de la cybersécurité la clé de voûte de la souveraineté numérique européenne, 28 recommandations pour la Présidence française du Conseil de l’Union européenne en matière de sécurité et de réglementation de l’espace numérique, septembre 2021, Agora FIC (page 9)
(14) https://eu2019.fi/fr/programme/programme-strategique
(15) https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20211008STO14521/pourquoi-la-cybersecurite-est-elle-importante-pour-l-ue
(16) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2391
(17) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3088
(18)
https://www.washingtonpost.com/national-security/russia-satellie-weapon/2021/11/15/0695621c-4648-11ec-973c-be864f938c72_story.html
(19) https://www.copernicus.eu/fr/services/securite
(20) https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-space-programme/
(21) https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-space-programme/
(22) https://portail-ie.fr/analysis/2799/les-cables-sous-marins-enjeu-strategique-pour-une-independance-numerique-europeenne
(23) https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/mission-starfish-il-faut-stopper-la-degradation-de-lhydrosphere-et-reparer-les-degats
(24) https://www.copernicus.eu/fr/propos-de-copernicus
(25)
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/05/24/apres-le-blocage-du-canal-de-suez-l-egypte-reduit-ses-exigences-d-indemnisation-pour-l-ever-given_6081276_3234.html
(26) https://www.irsem.fr/data/files/irsem/documents/document/file/2893/EM10_Marines-ailleurs.pdf
(27)
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly/discours-de-florence-parly-ministre-des-armees-voeux-aux-armees-le-jeudi-21-janvier-2021-a-balard
(28)
Soubrier (J.-B.), 2021, « Les fonds océaniques, un espace stratégique pour les armées françaises », Revue Défense Nationale, HS4, p. 125 à 138.
(29)+« Marines d’ailleurs », Études marines, n° 10 - Juin 2016, Centre d’études stratégiques de la Marine, p. 25.
(30) Cabestan (J.-P.), 2021, Demain la Chine : guerre ou Paix ?, Paris, Gallimard, p. 38.
(31) Idem, p 52.
(32) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_4709
(33) Marines d’ailleurs, No 10 - Juin 2016, Centre d’études stratégiques de la Marine, page 33
(34) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_5214
(35) https://eeas.europa.eu/sites/default/files/2_fr_act_part1_v1.pdf
(36) https://www.euromarfor.org/overview/1
(37) https://mer.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/21150_DP_Assises-Economie-Mer.pdf
Derrière cet article