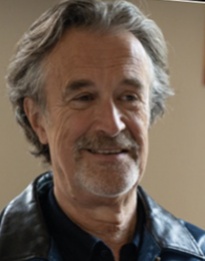Cet article a été écrit par Marc Poumadère, intervenant-chercheur à l'Institut Symlog. Il est issu du n°70 de la Lettre d'information sur les risques et les crises.
Comme chacun peut le constater, les crises de toutes sortes figurent en bonne place sur la scène médiatique et le changement climatique est maintenant rebaptisé « crise climatique » pour mieux souligner la gravité des conséquences. On pourrait donc conclure que la crise fait partie de notre culture, la fréquence avec laquelle elle est évoquée suggérant une compréhension commune au sein des représentations collectives, y compris sous l’angle satirique 1. Toutefois, aborder la culture de crise sous cette seule perspective serait réducteur, car elle recouvre des situations très différentes. Ainsi, de nombreux métiers, secteurs d’activité, institutions, et les valeurs elles-mêmes, sont dits en crise. Omniprésentes, ces crises ont en commun de combiner la dénonciation d’une situation dégradée et l’annonce de conséquences redoutées. En contraste, un autre type de crise correspond à la survenue d’une catastrophe, ce qui nécessitee une action immédiate pour limiter les risques de pertes humaines et matérielles. Les crises liées aux catastrophes font aussi l’objet d’une attention médiatique soutenue, qui fait entrer les événements dans le foyer de tout un chacun. Un troisième type de crise est celui où les pertes humaines restent dans un premier temps invisibles, silencieuses et ignorées tant par les médias que par la société dans son ensemble, avant d’être soudainement révélées pour apparaître au grand jour. Enfin, une mention particulière sera forcément faite de la crise climatique, puisque nous la retrouvons dans tous les cas de figure : elle est omniprésente, augmente la fréquence et la gravité des catastrophes, et les dangers qu’elle représente sont probablement sous-estimés. En analysant à l’aide d’exemples les caractéristiques qui distinguent ces différentes situations, nous tenterons de définir la place et le rôle de la culture de crise dans chaque cas.
Catastrophes et crises : principe de proximité et information des populations
Le physicien Eugene Wigner (1902-1995), lauréat du prix Nobel, propose un cadrage sans détour des catastrophes : « Si une grande quantité d’énergie se trouve à un endroit et qu’un grand nombre de personnes se trouvent au même endroit, il y a un potentiel catastrophique. » Est ainsi souligné le principe de proximité, qui caractérise notamment les accidents industriels et les crises qu’ils déclenchent. Lors d’une catastrophe, d’importantes ressources humaines et matérielles sont mobilisées en urgence, dès le choc initial, pour faire face à la confusion et répondre aux besoins des populations affectées, avant que des moyens permettant un retour à la normale (à plus ou moins brêve échéance selon la gravité et la nature des dommages) ne soient engagés. Mais le principe de proximité est pertinent également pour agir avant un possible accident, et informer la population locale des risques courus et de la conduite à tenir en cas d’accident. L’objectif visé est de réduire la vulnérabilité et donc l’étendue de la crise liée à une catastrophe : si la population est encouragée à adopter un comportement responsable et, dans la mesure du possible, à se prendre en charge. La panique et la désorganisation s’en trouvent limitées, ainsi que la charge de travail et l’exposition aux risques des services d’urgence. De plus, certaines catastrophes imposent d’ouvrir plus largement l’angle de réflexion, comme c’est le cas des accidents nucléaires. Le principe de proximité s’applique aux accidents nucléaires : un réacteur concentre des niveaux élevés d’énergie et, en cas d’accident grave, les premières victimes potentielles se trouvent parmi le personnel du site, les intervenants extérieurs et la population environnante. Toutefois, les accidents nucléaires ont montré que la crise associée à ce type de catastrophe s’étend bien au-delà des conséquences de proximité et affecte la société dans son ensemble. Les conséquences indirectes font que, même en l’absence de radiations liées à l’accident et sur des territoires éloignés, des problèmes de santé peuvent être observés (liés au stress, ou à des changements de régime alimentaire, par exemple) et d’autres effets sont constatés sur le tourisme et les exportations agricoles, alimentaires et autres. Pour tenir compte de ces écarts au principe de proximité, il est nécessaire de considérer attentivement les spécificités d’un accident nucléaire, comme l’abolition des distances (spatiales, temporelles, sociales et psychologiques), qui semblent communes aux accidents de Tchernobyl et de Fukushima, malgré le quart de siècle qui les sépare 2.
La culture de crise dans le cas des catastrophes passe donc par l’implication des riverains préalablement à l’événement redouté. De plus, pour le nucléaire, la culture de crise vise une meilleure compréhension des caractéristiques psychologiques et sociales de l’accident afin de renforcer la résilience des gens exposés à un flux soutenu d’informations potentiellement anxiogènes.
Sous-estimation des risques et révélation du réel
La France dispose d’un plan efficace pour la prévention des risques liés aux périodes de caniculae et il s’agit d’une retombée directe de la crise survenue en 2003. Que s’était-il passé ? Lorsque, au cours de l’été 2003 en France, les températures se sont stabilisées à des niveaux anormalement élevés, les médias ont fait état de la ruée vers les plages bondées et des baignades improvisées dans les fontaines urbaines. L’attention s’est ensuite portée sur les conséquences de la sécheresse pour le bétail et les récoltes. Puis les incendies de forêt sont devenus un sujet de préoccupation. Pendant ce temps, des milliers de victimes invisibles et silencieuses s’accumulaient, l’ampleur et la gravité de la situation restant ignorées jusqu’à ce que les morgues soient débordées et que la gestion des cadavres devienne problématique. Au total, en 2003, les canicules ont provoqué 19 490 décès supplémentaires en France 3. Comment expliquer un événement aussi catastrophique ? Les dangers pour la santé de températures élevées prolongées étaient correctement documentés. Une étude exhaustive (plus de mille références) de l’incidence des vagues de chaleur sur la mortalité dans les grandes zones urbaines a même été publiée dans une revue française en 2002. Malgré les savoirs existants, la France était peu préparée pour faire face à l’épreuve de 2003, laquelle a montré que les vagues de chaleur sont de fait une combinaison complexe de facteurs naturels et sociaux dont les dangers faisaient l’objet d’une atténuation sociale 4. Avant 2003, les morts dues à la canicule passaient inaperçues. C’est lors de l’évaluation de la mortalité de la canicule de 2003 que la mortalité associée à la canicule de 1976 fut recensée, soit, selon les études, de 4 500 à 6 000 décès supplémentaires. En 2003, la méconnaissance généralisée des dangers (malgré les études publiées), l’absence de vigilance de la part des autorités comme de la population, l’incapacité à interpréter les signes alors même que les taux de mortalité augmentaient anormalement, ont entravé la réactivité de tous les acteurs. L’ampleur de la catastrophe a provoqué une sortie de la cécité. La France dispose à présent d’un programme d’alerte et de gestion des risques liés aux canicules.
Quel rôle de la culture de crise peut-on dégager de cette étude de cas ? Concrètement, la crise se caractérise ici par le passage brutal d’une sous-estimation collective des risques à une amplification sociale de ces risques, lorsque la révélation de la catastrophe s’impose à tous. Les pouvoirs publics comme la population considèrent alors de nouvelles façons de penser et d’agir, lesquelles contribuent à redéfinir les représentations collectives de la canicule. Dans ces conditions, la culture de crise permet de porter un regard nouveau sur les facteurs de sous-estimation des dangers associés aux vagues de chaleur, pour qu’ils soient identifiés à tous les niveaux et combattus. Les résultats sont éloquents : les évaluations montrent que la mortalité associée aux canicules depuis 2003 en France a fortement diminué. On pourrait rétorquer que cette analyse est possible après les faits, après la survenue d’une crise mettant un terme soudain à l’atténuation sociale d’un risque, mais serait-il possible d’envisager une application préalable, c’est-à-dire une analyse permettant d’identifier un risque alors qu’il est socialement atténué et avant qu’il ne se transforme en crise ? Cette identification s’avère difficile car le processus d’atténuation relève autant d’une forme active de déni que d’une cécité passive. Une situation actuelle semble toutefois s’inscrire dans ce processus si l’on prend en compte les statistiques fournies par les services spécialisés du ministère de l’Intérieur sur les « homicides volontaires et tentatives d’homicides volontaires entre délinquants » : en 2021, ils s’élevaient à 203, en 2022 à 236, et la tendance croissante se poursuit en 2023 5. Les statistiques précisent que les victimes sont jeunes, parfois mineures, et que plus de 90 % d’entre elles sont mêlées au trafic de stupéfiants (pour l’essentiel du cannabis, dont la France est le premier pays consommateur en Europe). La chaîne causale de la mortalité de ces jeunes étant connue, on peut se demander ce qui empêche d’intervenir et d’éviter ces morts violentes et ces tentatives d’homicides prévisibles. La première analyse, qu’il conviendrait d’approfondir, met en évidence plusieurs éléments. Ainsi, le cadrage des événements met en avant le trafic de drogues, les luttes entre bandes rivales, l’insécurité des quartiers. Le néologisme « narchomicide » a même été créé récemment. Il en résulte une forme de stigmatisation, laquelle peut expliquer le peu d’émotion soulevée par les reportages concernant les victimes, lesquelles restent le plus souvent anonymes, sauf quand des victimes dites collatérales sont atteintes. Cette terminologie empruntée au domaine militaire nous rappelle l’ambiance de « guerre contre les drogues », à laquelle il est fait souvent référence. Et comme dans toute guerre, il y a des victimes, les cyniques se font parfois entendre pour se satisfaire d’une situation dans laquelle des délinquants se tuent entre eux. L’opposition entre les rares victimes collatérales, qui seraient des morts innocents, et les autres victimes, qui seraient comme exécutées parce que coupables, est exploitée. À la différence des morts de la canicule, les pertes humaines sont ici dénombrées mais elles restent occultées par la stigmatisation sociale. Quels événements pourraient conduire à une prise de conscience de cette situation ? Nombre de victimes socialement inacceptable ? Mobilisation des familles endeuillées ? Opinion devenue capable d’enlever le masque de la stigmatisation pour appréhender différemment la réalité ? Avec la crise qui suivra le dévoilement de cette situation, les mesures pour protéger la vie de ces jeunes seront prises.
La culture de crise dans le cas de la sous-estimation collective de risques suppose non seulement d’identifier la situation problématique qui sinon reste inaperçue, mais aussi d’analyser les facteurs de l’atténuation sociale qui empêchent les spécialistes et la population de s’emparer de l’enjeu en question.
Paradoxe des crises annoncées et engagement
Les crises résultant de la révélation soudaine de risques préalablement ignorés sont caractérisées par l’absence d’annonce et d’engagement : l’atténuation sociale empêche tous les acteurs de se figurer la crise, d’en entrevoir même la possibilité. En contraste, presque quotidiennement, des crises d’une grande diversité sont annoncées dans les médias, avec des références plus ou moins précises aux causes et aux conséquences d’une situation jugée dégradée. Ces crises, omniprésentes, couvrent un large éventail de domaines, allant des institutions (école, hôpital) aux interactions sociales et aux valeurs (confiance, rapport à l’autorité) et elles s’invitent dans le débat public avec des questionnements et des controverses portant à la fois sur les diagnostics et sur les solutions. L’engagement dans les réponses aux crises annoncées s’inscrit dans le paradoxe que ces annonces représentent dans chaque environnement. Alors que les crises omniprésentes sont clairement présentées comme une situation de fait, les crises liées aux catastrophes relèvent de l’irruption brutale et de l’effet de surprise, ce qui entraîne la mobilisation immédiate des moyens d’interventions. Pour être prêts à intervenir, les professionnels de la gestion de crises doivent auparavant intégrer les données et le savoir-faire issus de l’historique d’accidents, du retour d’expérience ou des exercices de simulation se rapprochant le plus possible de situations réelles. Même si, dans ce cas, la crise n’est pas annoncée comme le sont les crises omniprésentes, on peut dire qu’elle est attendue puisque le haut niveau de préparation implique que tous les professionnels soient convaincus qu’une catastrophe peut se produire pour être prêts. Paradoxalement, ce type d’attente est requis et utile pour éviter la survenue de crises ou en modérer l’étendue. L’état de crise permanent qui caractérise souvent les crises omniprésentes n’est pas de nature à déclencher des interventions dans l’urgence comme pour les crises liées à des catastrophes. Toutefois, les crises omniprésentes ne devraient pas être délaissées car elles révèlent des dysfonctionnements ne pouvant s’exprimer autrement dans des circonstances données. Si l’on retient le cas de l’hôpital en crise, la question d’aborder une organisation complexe en décelant un angle d’analyse pertinent se pose. Ainsi, lors de la gestion de l’épidémie du SARS-CoV-2, l’obligation vaccinale a été décidée pour le personnel hospitalier dans son ensemble (obligation suspendue en mai 2023). Si le débat s’est surtout focalisé sur le licenciement puis la réintégration des soignants non vaccinés, il pourrait être intéressant de se pencher sur les différences dans le respect de cette obligation selon les catégories de personnel : en quasi-totalité pour les médecins, un peu moindre pour les infirmiers et encore moindre pour les aides-soignants. Certes, on peut expliquer cet écart par les différences entre les groupes socioprofessionnels en présence, mais il est important de rappeler que ces catégories de personnel, ainsi que les agents techniques et administratifs, contribuent tous à la réussite de la mission de l’hôpital, qui est d’accueillir des personnes vulnérables pour les soigner. Il conviendrait donc d’étudier dans quelle mesure la différence dans le respect de l’obligation vaccinale exprime une différence de proximité avec la mission de cette organisation. En d’autres mots, il n’est pas certain que toutes les catégories de personnel, avec leurs rôles propres, s’engagent dans cette mission au maximum de leurs compétences. Une hypothèse serait celle de l’ignorance organisationnelle qsue la réussite de la mission de l’hôpital est le produit de la mobilisation des compétences de tous les membres du personnel 6. Un effet de la prise de conscience de cette interdépendance serait de rapprocher de la mission de l’hôpital ceux qui s’en trouvaient auparavant éloignés. Cette approche pourrait accompagner la réponse aux enjeux relevant du manque de moyens et d’effectif, la culture de crise ayant pour but, dans ce cas, de mettre un terme à un état de crise permanent.
Quant à la crise climatique, elle occupe une place à part dès lors qu’elleparticipe de toutes les crises : omniprésente dans les médias, elle se trouve également associée à des catastrophes de fréquence et gravité croissantes et son étendue demeure vraisemblablement sous-estimée tant elle atteint en fait la totalité des domaines. Présente de façon croissante dans les préoccupations du public, cette crise s’accompagne d’un sentiment d’impuissance pouvant conduire à l’éco-anxiété. Les graves dangers comme les mesures à prendre sans tergiverser sont décrits par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), sachant que les populations vulnérables, en particulier celles des régions côtières de faible altitude et des pays en développement, sont touchées de manière disproportionnée. Cette polycrise, caractérisée par des crises imbriquées et superposées affectant l’humanité 7, devrait enclencher une forme de solidarité : « Lorsque l’humanité tout entière est menacée, la conscience sociale nous conduit à rechercher collectivement des solutions [...] pour combattre collectivement tout ce qui compromet notre avenir commun et celui des générations futures 8. » Comment expliquer alors la relative inaction des gouvernements et des populations lorsqu’il est question de s’engager à l’échelon mondial dans une mise en œuvre coordonnée de ces mesures ? Bien que soumise aux menaces annoncées de la crise climatique, l’humanité ne paraît malheureusement pas faire l’objet, jusqu’à présent, d’un attachement qui se traduirait par un engagement collectif à la hauteur des enjeux. Pourtant, les nombreux liens familiaux, professionnels, civiques, culturels, montrent l’existence de fortes capacités d’attachement et d’engagement 9, y compris à l’égard d’animaux domestiques, comme l’a montré le cas récent du chat Neko 10.
Les systèmes de représentations associés jusqu’à présent à la gestion des crises paraissent inopérants pour la crise climatique. En termes de culture de crise, il s’agirait donc de construire des liens entre nos attachements familiers et l’attachement envers l’humanité, si proche et si lointaine, cependant qu’elle est menacée par le changement climatique.
Nous pouvons finalement souligner que le recours généralisé à la crise pour désigner un ensemble disparate de phénomènes ne peut se traduire par une essentialisation de la culture de crise, car celle-ci consiste à prendre en compte conjointement les conditions de l’existence d’une crise et l’existence même de cette crise. Sans ignorer les apports de la culture organisationnelle et de la culture du risque et de la sécurité, ses devancières, la culture de crise construit ainsi ses propres approches. La crise n’est pas considérée ici comme un événement isolé. Afin de faire face aux défis contemporains, d’une culture des réponses il faut passer à une culture de questionnement, de discernement et d’invention 11. La caractéristique centrale de la culture de crise est d’ouvrir l’analyse à la société dans son ensemble, que ce soit par exemple pour mieux comprendre et traiter les conséquences non radiologiques d’un accident nucléaire, pour dessiller le regard porté sur la mort violente de jeunes, pour mettre un terme à l’état de crise permanent d’une organisation, ou pour affermir l’attachement à l’humanité tout entière en vue d’une lutte solidaire contre les dangers du changement climatique. Malgré la multitude de crises qui occupent déjà nos esprits, il faut aussi chercher l’autre crise, celle qui n’a pas encore été prise en compte dans nos analyses. La culture de crise devient ainsi un champ d’investigation et de formation à part entière, qui utilise l’interdisciplinarité et le croisement des expertises pour contribuer à libérer l’avenir des menaces qui le compromettent.
Notes
(1) Ainsi le Canard enchaîné du 4 octobre 2023 titrait-il en première page : « Les punaises de lit vont-elles provoquer une crise au sommier de l’État ? »
(2) Poumadère M., « Que faut-il savoir d’un accident nucléaire pour une meilleure prise en compte des conséquences sur la société ? », dans Merad M., Dechy N., Dehouck L. et Lassagne, M. (dir.), Risques majeurs, incertitudes et décisions, MA Éditions – ESKA, 2016.
(3) Robine J.-M., Cheung S. L. K., Le Roy S., Van Oyen H., Griffiths C., Michel J.-P. et Herrmann F. R., « Plus de 70 000 décès en Europe au cours de l’été 2003 », Comptes rendus Biologies, 331, 2, 2008.
(4) Poumadère M. et Mays C., « The dynamics of risk amplification and attenuation in context. À French case study », dans N. Pidgeon, R. Kasperson et P. Slovic (dir.), Risk Communication and social amplification of risk, Cambridge University Press, 2003.
(5) Piel S. et Saintourens T., « Dans les règlements de comptes liés au trafic de drogues, des agresseurs et des victimes de plus en plus jeunes », Le Monde, 31 mai 2023.
(6) Référence par analogie à la loi de Lusser (Robert Lusser, 1899-1969), selon laquelle la fiabilité d’un système ne dépend pas du maillon le plus faible, comme on le croit communément, mais du produit de la fiabilité de chaque élément.
(7) Morin E., Kern A. B., Kelly S. M. et LaPointe R., Homeland Earth. À Manifesto for the New Millenium. Advances in Systems Theory, Complexity, and the Human Sciences, Hampton Press, 1999.
(8) Paugam S., L’attachement social. Formes et fondements de la solidarité humaine, Le Seuil, 2023.
(9) Ibid.
(10) Le 2 janvier 2023, gare de Montparnasse à Paris, le chat Neko échappe à l’attention de son propriétaire et se réfugie sous un train. La SNCF ayant refusé de retarder le départ, le chat sera découvert écrasé après le passage du train. Une pétition de protestation a été lancée et a recueilli plus de 100 000 signatures, la fondation 30 Millions d’amis a porté plainte et un procès est intenté contre la SNCF.
(11) Lagadec, P., Sociétés déboussolées. Ouvrir de nouvelles routes, Persée, 2023.
Derrière cet article