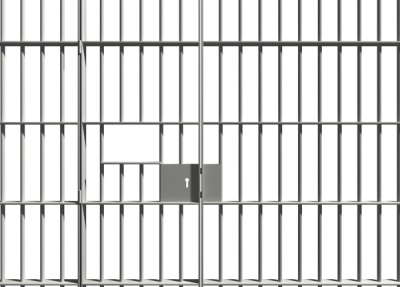
Cet article a été écrit par Iman El Feki, doctorante en sociologie à l'Université de Strasbourg, laboratoire SAGE (UMR 7363). Il est issu du n°58 des Cahiers de la sécurité et de la justice.
Cet article explore les effets potentiels du dispositif actuel de prise en charge de la radicalisation violente en détention sur les personnes détenues, prévenues ou condamnées, pour des faits de terrorisme ou des faits de droit commun mais évalués par l’administration pénitentiaire comme radicalisées. Dans une approche pragmatique, il examine les parcours de peine et leurs conséquences en regard des objectifs de réinsertion annoncés par l’institution. Il tend à montrer les difficultés de l’administration pénitentiaire à mettre en œuvre un projet de réinsertion individualisé, enchevêtré dans de multiples contraintes institutionnelles et sécuritaires, peu spécifiques à ce public.
Les enjeux de (ré)intégration sociale sont nombreux en sortie de détention, quels que soient les faits commis. Dans le cas des personnes condamnées pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste (AMT), c’est tout aussi vrai, si ce n’est plus, notamment quand les faits commis, au-delà de leur matérialité, s’en prennent symboliquement à toute une partie de la société, voire à la société tout entière. Que dire de la (ré)insertion d’une personne qui non seulement a des difficultés à trouver sa place dans la société (et à qui la société a du mal à faire une place), professionnellement et socialement, mais qui en plus ne souhaite pas y appartenir voire la considère comme l’ennemie ?
La gestion pénitentiaire des personnes condamnées pour AMT est souvent considérée comme une gestion d’exception. Mais lorsqu’il s’agit de considérer le sens de la peine en détention, cet enjeu prend plutôt un sens paroxystique auprès de cette population, tout comme les difficultés de l’administration pénitentiaire (AP) à y répondre. En effet, si les paradoxes de la politique de lutte contre la radicalisation ont déjà été soulignés [Sèze, 2019], ils s’illustrent particulièrement dans le parcours de détention de ces individus. Cet article propose de contribuer à analyser les étapes et les ressorts de ce parcours de peine, tout en en observant les effets sur les possibilités de réintégration sociale 1.
La stratégie de lutte contre la radicalisation violente en détention
Dans son audition devant la commission d’enquête sur les dysfonctionnements et manquements de la politique pénitentiaire française à l’Assemblée nationale (21 octobre 2021, compte rendu no 24), le chef de la mission de lutte contre la radicalisation violente (MLRV) explique que cette mission, qui a vu le jour en 2015, a trois objectifs qui structurent son action : la gestion de la détention, notamment du « risque de violence et [du] risque d’influence par des actions de prosélytisme » ; la « sécurité des personnels pénitentiaires ainsi que des codétenus » ; et enfin la « sécurité de la société par une préparation active des conditions de libération » [Assemblée nationale, 2021, p. 3]. Le chef de la MLRV explique ensuite la consécution de deux phases pour répondre à ces objectifs : la détection et l’évaluation. La détection se construit d’après une grille d’évaluation interne à l’AP reprenant « les signaux faibles et forts de radicalisation violente » [Assemblée nationale, 2021, p. 3] et mise à la disposition des différents personnels (surveillants, conseillers d’insertion et de probation, cadres, etc.). Ensuite, l’évaluation se fait dans l’établissement où est détenue la personne placée sous main de justice (PPSMJ), puis se poursuit dans les quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER), quartiers dédiés à ce public dans lesquels ils sont envoyés pour une durée d’une quinzaine de semaines. À l’issue de cette évaluation, les PPSMJ sont orientées selon différents modes de détention : en quartier d’isolement en cas de risque de passage à l’acte violent, en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) si les personnes sont fortement imprégnées idéologiquement et en détention ordinaire (dans des établissements sélectionnés selon des conditions minimales de sécurité) si elles ne présentent aucun de ces deux risques [Assemblée nationale, 2021, p. 4]. Pour les deux derniers, une prise en charge psychosociale individualisée est mise en œuvre sur la base des évaluations mentionnées précédemment.
Les quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER)
Les personnes condamnées pour AMT sont systématiquement envoyées dans les QER. Quant aux personnes prévenues pour ces faits, l'instruction de leur affaire peut durer plusieurs années. Elles sont généralement incarcérées en l’attente de leur procès et sont donc également envoyées dans ces quartiers d’évaluation. Cela peut soulever différentes questions, quant au respect de la présomption d’innocence de ces personnes, d’une part, et, d’autre part, quant à la possibilité pour les professionnels d’évaluer la radicalisation de personnes sans aborder les faits dont elles sont accusées, comme l’impose le respect de la procédure judiciaire. Une fois que toutes les personnes prévenues ou condamnées pour des faits de terrorisme sont passées dans un des six quartiers spécialisés, ce sont les personnes condamnées pour des faits de droit commun mais évaluées par l’administration pénitentiaire comme étant radicalisées (DCSR) qui y sont envoyées. Cette affectation en quartier d’évaluation ne fait pas l’objet d’une décision de justice mais seulement administrative. Elle doit se faire, en théorie, avec le consentement de la personne concernée. Toutefois, les travaux de Chantraine et Scheer sur ces quartiers ont montré la dimension institutionnellement contrainte de ce « choix » (Chantraine et al., 2022, p. 378). De plus, ils mettent en avant le « climat guerrier » de ces quartiers hautement sécuritaires (Chantraine et al., 2018, p. 74 ; Chantraine et al., 2022, p. 379). Ce climat, construit à la fois par les personnes détenues et l’institution carcérale, conditionne en grande partie les interactions entre professionnels et personnes détenues. En effet, les dispositifs particulièrement sécuritaires mis en place dans ces quartiers dédiés contribuent à le rappeler dans toute interaction, dans tout mouvement, dans tout acte du quotidien. Dans cette configuration, de nombreux professionnels s’inquiètent des effets du renforcement institutionnel du stigmate de « terroriste » ou de « combattant » sur les personnes détenues, critique que ces derniers formulent également (Chantraine et al., 2018, p. 181-182). Les auteurs relèvent le quasi-consensus des acteurs sur la critique de l’énoncé performatif qui « consiste à produire l’ennemi par sa désignation en tant que tel » (Ibid., p. 184). Ils notent également les inquiétudes des professionnels quant à l’avenir de ces personnes détenues, redoutant « d’être contre-productif et de contribuer potentiellement à entretenir les desseins terroristes » (Ibid., p. 184).
Au-delà de ces problématiques, qui pourraient s’avérer d’avantage archétypiques qu’exceptionnelles au sein de l’institution carcérale (Ibid., p. 184), et dont on peut aisément s’interroger sur les implications en sortie de détention, il est également important de souligner les conditions socio-professionnelles de cette détention. En effet, l’arrivée en QER ne permet pas la poursuite ou la mise en place d’activités professionnelles ou culturelles, ni de formations, et ce, durant toute l’évaluation.
Le quartier d'isolement
À l’issue de cette période, les personnes détenues peuvent être orientées de différentes manières, comme mentionné précédemment. L’affectation la plus sécuritaire est sans doute celle en quartier d’isolement. Censée être exceptionnelle, l’affectation en QER est l’objet d’un tout autre usage pour ces détenus, comme l’explique le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport de janvier 2020 : « le placement au quartier d’isolement préconisé en QER devient une affectation officielle, de longue durée qui revient à faire de l’isolement un régime de détention autonome et durable appliqué sans fondement juridique 2 ». En septembre 2020, 14,3 % des personnes AMT et 12,0 % des DCSR sont à l’isolement 3. Nous n’avons pas de chiffres disponibles permettant de déterminer quel pourcentage de ce public passe par cette affectation au moins une fois pendant la peine, et pour combien de temps en moyenne. Ce régime de détention implique un encellulement individuel et l’absence de contact avec toute autre personne détenue. Selon le profil des personnes placées à l’isolement, les surveillants, équipés de gilet pare lames, peuvent intervenir à trois ou quatre à l’ouverture de porte, après avoir entravé la personne par des menottes. Le détenu passe vingt-trois heures sur vingt-quatre seul dans sa cellule. Une heure est autorisée en promenade, dans une petite cour (8 ou 9 m2 en général), que la lumière du jour éclaire à travers les grillages qui la surplombent. Si l’accès aux activités culturelles, sportives et professionnelles n’est en théorie pas restreint par ce régime de détention (à distinguer du quartier disciplinaire), il est anecdotique en pratique. Les conséquences néfastes de ce régime de détention sur la santé physique et mentale des personnes détenues étant bien connues 4, on s’interroge d’autant plus sur ses effets sur des personnes engagées dans un processus radical voire violent. Les condamnations à perpétuité étant plutôt minoritaires, on peut se questionner sur les effets d’une telle détention sur ces personnes qui sont destinées à rejoindre la société civile après leur peine. S’il est rare qu’une personne détenue effectue la totalité de sa peine en quartier d’isolement, les années passées dans ce régime de détention n’en sont pas moins lourdes de conséquences. Face à certaines personnes détenues, il peut être compliqué d’envisager d’autres régimes que celui-ci (nombreux passages à l’acte violent, effets majeurs sur le reste de la détention, etc.). Toutefois, dans cette dynamique interactionnelle entre la personne et l’institution, les effets produits restent souvent contraires à ceux recherchés. L’engagement radical de la personne s’ancre d’autant plus profondément dans son parcours de vie que son quotidien à l’isolement la pousse à le nourrir de cette violence légitimée. Un effet de renforcement de l’étiquette de guerrier peut alors rencontrer des mécanismes calcifiants de survie psychique, ce qui rend une prise en charge ultérieure plus que délicate pour les professionnels de l’Administration pénitentiaire (carnets de terrain, juin 2021).
Les quartiers de prise en charge de la radicalisation
À l’issue de l’évaluation en QER, les personnes détenues peuvent également être orientées vers un quartier de prise en charge de la radicalisation. Dans la doctrine de ces quartiers, il est indiqué que les personnes qui y sont affectées doivent présenter un fort ancrage idéologique mais être « accessibles à la prise en charge ». Une attention particulière est portée sur les dynamiques de groupe, les personnes détenues, choisies selon leur profil, étant regroupées par cinq ou six. Des activités de tout type peuvent être proposées dans l’objectif de cette prise en charge de la radicalisation : suivi avec le psychologue et l’éducateur de la MILRV, suivi avec le médiateur du fait religieux, activités culturelles et sportives, etc. En pratique, ce quartier, étanche du reste de la détention, ressemble davantage au régime de détention des QER. Les personnes détenues n’ont pas accès au travail, et pas systématiquement à l’unité locale d’enseignement (selon les besoins exprimés et les possibilités de détacher un enseignant, parfois pour une seule personne). De plus, le faible taux d’occupation de ce quartier de dix-neuf places (21 % au moment de la visite du CGLPL de juin 2021 5, ce qui correspond globalement à ce qui est observé pendant la durée du terrain de cette recherche) rend difficile pour les professionnels de penser toute prise en charge de groupe ou encore d’organiser des activités ayant du sens. S’ajoute parfois à cela le peu de pertinence dans l’orientation de certaines personnes dans ces quartiers en vue de leur parcours d’exécution de peine, de leur rapport à la prise en charge ou à l’engagement radical qui rend difficile la construction d’une dynamique de groupe bénéfique. On a par exemple retrouvé dans la même session une personne ayant une très longue peine à effectuer et une personne à quelques semaines de sa libération ; une personne refusant tout contact avec le personnel (en dehors d’un oui/non écrit) au nom de son engagement radical et un jeune détenu ayant fait l’apologie du terrorisme dans un cadre interactionnel de provocation souvent retrouvé chez les jeunes adultes (Bonelli et Carrié, 2018) [Carnets de terrain, juillet 2021]. Des professionnels rapportent ainsi les propos d’une personne détenue affectée au QPR et demandant son transfert par peur de « se radicaliser » sous l’influence des autres (Carnets de terrain, juillet 2021). Un professionnel rapporte également l’effet des passages en QER sur la prise en charge au QPR :
« À la sortie des QER, des détenus ne veulent plus communiquer avec des BS [éducateurs et psychologues] parce qu’ils se sont sentis jugés, de façon frontale. […] C’est pas la même approche, l’évaluation se fait en très peu de temps, en très peu d’entretiens ; ils me disent “j’ai l’impression que c’est la garde à vue” ; y a pas le temps de créer du lien, c’est du questions-réponses » (entretien, juillet 2021).
Des incidents sont plusieurs fois rapportés à propos de « blocages » de personnes détenues : dans un mouvement collectif, elles décident de boycotter les activités du quartier, de refuser les entretiens avec les professionnels, ce qui rend toute prise en charge impossible. Ces stratégies de résistance (Chantraine et al., 2022, p. 389) peuvent avoir différents motifs. Souvent, elles sont d’ordre contestataire. Par exemple, plusieurs personnes détenues se sont senties trahies par les interventions d’un médiateur du fait religieux et ont contesté les propos rapportés par cette personne au reste de l’équipe, sans pour autant remettre en question l’ensemble de la prise en charge. D’autres fois, ce sont des motifs idéologiques ou institutionnels qui sont invoqués par un petit nombre de personnes détenues, qui s’appliquent ensuite à rallier à leur cause les autres personnes. Dans ce cas-là, c’est contre le principe même du quartier de prise en charge de la radicalisation que protestent les personnes détenues, dans une dynamique de circulation des pratiques de résistance d’un QPR à l’autre (par les transferts fréquents de ces détenus notamment). Le quartier est alors paralysé et les personnes détenues sont transférées. Ce type d’événements, loin d’être anecdotique dans la vie du quartier, semble révéler les nombreuses limites de ce dispositif.
En effet, si la doctrine de ce quartier semble promouvoir la prise en charge individualisée des personnes détenues, elle se met en œuvre dans un cadre institutionnel bien plus large qui la contraint. Les affectations en QPR sont forcément prises dans des réflexions complexes de gestion de flux en détention, dans des impératifs sécuritaires et judiciaires (certaines personnes impliquées dans la même affaire ne pouvant être regroupées par exemple), dans des décisions pragmatiques liées aux ressources humaines et organisationnelles d’un système carcéral surpeuplé, bien au-delà du public AMT/DCSR. Ce quartier spécialisé proposant de nombreux projets apparaît rattrapé par sa condition institutionnelle. Un professionnel explique à ce sujet : « On leur dit [aux personnes détenues] qu’on ne comprend pas non plus leur affectation [en QPR], ça calme un peu les tensions dans la relation » (carnets de terrain, juillet 2021). Ces éléments cumulés contribuent à endommager l’adhésion de la personne détenue à son parcours d’exécution de peine et de fait à fragiliser son lien à l’institution et aux professionnels qui la représentent au quotidien, à leur grand dam.
La détention ordinaire
Lorsque les PPSMJ sont orientées en détention ordinaire, elles sont transférées dans un des établissements dits sensibles, c’est-à-dire en mesure de les accueillir d’après des critères essentiellement sécuritaires. Là où le QPR symbolise le choix d’une politique de regroupement des personnes détenues condamnées pour AMT ou DCSR, l’orientation en détention ordinaire, à l’inverse, est celui de la dispersion. Avec cette décision, l’administration pénitentiaire estime qu’il n’y a pas de risque de passage à l’acte ni de risque de prosélytisme en détention.
Le régime de détention effectif va particulièrement varier d’un établissement pénitentiaire à un autre, à l’image des variations que rencontre toute personne détenue d’un établissement à l’autre. Cela va dépendre des possibilités d’accéder au travail, à la formation professionnelle, des ressources de l’unité locale d’enseignement, de la présence de coordinateur culturel ou non, des ressources humaines en général, de la situation géographique de l’établissement (dans la ville ou non, desservi par les transports en commun ou non, etc.) ou encore de son régime de détention : ouvert (c’est-à-dire avec la possibilité de circuler librement dans l’établissement à des horaires fixés dans la journée) ou fermé (pas de circulation autonome). Tous ces éléments créent des conditions de détention inégales d’un établissement à l’autre, sans spécificité pour les personnes détenues dont nous nous occupons ici. Toutefois, lorsque ces ressources existent, elles ne sont pas accessibles de la même manière à ces personnes détenues qu’aux autres, notamment dans l’accès au travail qui reste minoritaire (les établissements expliquent cette réticence du fait de l’autonomie laissée à la personne détenue dans de nombreuses fonctions d’auxiliaire 6).
En détention ordinaire, les effets du stigmate de terroriste peuvent également avoir de nombreuses conséquences, dans l’appréciation qui est faite de leur dangerosité comme dans leurs relations avec les autres personnes détenues. En effet, lorsque les personnes condamnées pour AMT ne côtoient en détention que des personnes ayant la même qualification, le personnel de l’établissement, interprétant cela comme un refus d’interagir avec les autres, s’inquiète de leur degré d’imprégnation idéologique. À l’inverse, lorsqu’une personne condamnée pour AMT fréquente régulièrement des personnes détenues de droit commun, on fait retentir les alarmes du prosélytisme, et on questionne l’engagement radical de ces personnes, les faisant entrer dans la catégorie des DCSR. La lutte contre la dissimulation, la taqiya, prenant une place grandissante dans l’interprétation des comportements en détention (Chantraine et al., 2018, p. 190), toutes les situations mènent à la suspicion, risquant « toujours de produire des figures de la dangerosité, conforme aux intuitions initiales » (Ibid., p. 190) et ne laissant que peu de place à un parcours de désengagement concrétisé par de nouvelles relations sociales. Une directrice d’établissement explique cette situation par un « manque de formation des personnels » et appelle à une « nécessaire réforme de l’interprétation de ces comportements » (carnets de terrain, octobre 2021), de manière à laisser la possibilité aux personnes détenues « d’être autre chose que des terroristes ».
Dans la plupart des établissements concernés par cette recherche, l’accès aux ressources éducatives, sportives et culturelles se fait à présent cas par cas, et revient autant que possible à une décision individualisée et pas uniquement liée à l’intitulé de la condamnation. Ce point est d’autant plus important à souligner que ce n’est pas souvent le cas dans la gestion de ces personnes détenues, alors qu’on connaît l’hétérogénéité des situations recoupées par cette qualification judiciaire d’AMT (financement du terrorisme par l’envoi d’argent à un proche, combat sur zone irako-syrienne, tentative de départ, préparation d’attentats, participation logistique, etc.). Les personnes font l’objet d’un suivi rapproché par différents professionnels, notamment le trio psychologue et éducateur de la MILRV et conseiller d’insertion et de probation « référent radicalisation ». Si ce n’était pas le cas à l’arrivée des éducateurs et psychologues (en 2015-2016), ces professionnels coordonnent aujourd’hui leur travail, en se répartissant les objectifs de la prise en charge et en partageant des outils d’accompagnement. De plus en plus, l’approche psycho-criminologique 7 est mobilisée par les éducateurs et les psychologues, qui tentent de comprendre la place et le sens de l’engagement radical dans le parcours de vie de la personne, de mettre en lumière ses facteurs de risque et de protection. Ainsi, lors de la prise en charge psycho-éducative menée auprès de la personne détenue, le sens de la peine est travaillé et la projection vers la sortie peut se faire lorsque la fin de peine se profile. Un travail est notamment fait sur la place de la personne dans sa famille et dans la société civile qu’elle est amenée à rejoindre (sens, rôles, rapport à la violence et à la loi, etc.). Les professionnels, qui ont souvent trop peu de temps à accorder à la prise en charge des personnes détenues, aimeraient que le suivi dont les condamnés pour AMT bénéficient généralement du fait des moyens spécifiquement alloués (professionnels, budget d’actions culturelles et sportives, programmes de prévention de la radicalisation violente, etc.) soit également proposé à toutes les personnes détenues. Les éducateurs et psychologues de la MILRV n’interviennent que sur la base du volontariat. Les PPSMJ ont le droit de refuser de les rencontrer. S’il est évident que souvent les PPSMJ acceptent ces rencontres par crainte d’être mal perçus par l’institution ou par intérêt (bénéfices secondaires, étiquettes en détention, espoir d’aménagement de peine, interactions humaines, etc.), les professionnels développent ensuite une relation d’accompagnement qui se fait la plupart du temps avec l’adhésion de la PPSMJ.
Quelles (dys)continuités de la prise en charge ?
Le chef de la MLRV reconnaît toutefois que ces dispositifs ont été élaborés « de façon assez empirique depuis 2015, en confrontation avec la réalité, à savoir l’accueil et la gestion de détenus prévenus ou condamnés pour faits de terrorisme » [Assemblée nationale, 2021, p. 3]. De ce fait, les personnes incarcérées dès le début des années 2010 ou même à partir de 2015 ont vu arriver différents dispositifs modifiant leur parcours d’exécution de peine au fur et à mesure de leur mise en œuvre. Cela provoque un certain nombre de difficultés qui se répercutent de différentes manières sur les parcours de peine des personnes détenues. Par exemple, plusieurs personnes détenues sont incarcérées en détention ordinaire, y effectuent leur peine sans problèmes, bénéficient d’un suivi psychosocial et d’un projet de formation professionnelle depuis plusieurs années, mais sont envoyées en QPR lors de l’ouverture de ces quartiers. C’est un retour en régime de détention sécuritaire et une mise en question de leur engagement radical voire violent qui est vécu par les PPSMJ comme un retour en arrière dans la construction d’une relation de confiance éprouvée avec les professionnels et l’institution, et de fait une perte de sens et de l’engagement dans la prise en charge (carnets de terrain, juillet 2021).
De même, ces effets peuvent également se retrouver en sortie de QER, lorsque l’orientation préconisée par l’équipe du quartier d’évaluation – annoncée à la PPSMJ lors de la lecture de sa synthèse pluridisciplinaire – n’est pas suivie par l’administration centrale. Certaines PPSMJ ont une orientation en détention ordinaire avec rapprochement familial, mais sont envoyées en QPR, régime de détention significativement plus sécuritaire. D’autres encore sont orientées vers la détention ordinaire, l’administration centrale approuve cette orientation, mais l’établissement, ne s’estimant pas en mesure de les gérer en détention, les place en quartier d’isolement à leur arrivée. Ces évènements sont vécus par les PPSMJ comme une injustice, l’orientation exprimée par la synthèse du QER étant vue comme une juste rétribution de leur engagement et de leur participation à l’évaluation. Plusieurs expriment ensuite une perte de confiance en l’institution, et estiment vain leurs efforts dans le désengagement et la réintégration puisque de toute manière, ils sont renvoyés à leur figure dangereuse par des orientations plus sécuritaires (carnets de terrain, 2020-2021 ; écrits professionnels).
Enfin, à l’approche de la sortie de détention, différentes administrations s’interrogent sur les conditions judiciaires et administratives de celle-ci (aménagements de peine, mesures judiciaires, mesures administratives, etc.). Ces questionnements les poussent à se tourner vers les écrits de l’administration pénitentiaire, notamment ceux du QER. Mais parfois, cette évaluation date de plusieurs années et ne reflète pas l’évolution potentielle de la PPSMJ pendant sa peine. Il est donc décidé, sur demande des magistrats (carnets de terrain, novembre 2021), de renvoyer systématiquement les personnes en QER dans les six mois précédant leur sortie de détention pour obtenir une évaluation au plus proche de leur situation actuelle. Si l’on comprend aisément les motivations d’une telle décision, elle n’est pas sans conséquence sur la PPSMJ. En effet, ce renvoi en QER entraîne d’importants changements de conditions de détention (retour à un régime ultra-sécuritaire), la perte du travail ou l’interruption de la formation (même en cas de passages de diplômes annuels, type baccalauréat), l’absence d’activités culturelles et éducatives, le changement de l’équipe de professionnels, et surtout la remise en cause du parcours de désengagement par le retour massif de la suspicion de dangerosité. Tout cela mène à une discontinuité significative dans l’application de la peine et de son sens et constitue un frein organisationnel et économique substantiel à la préparation de la sortie (perte de revenus, impossibilité d’accomplir les démarches administratives nécessaires à la sortie concernant le logement ou l’aide sociale à la réinsertion, éloignement de la famille, etc.). De plus, on peut se poser la questtion des effets du retour de dispositifs institutionnels guerriers sur le parcours de désengagement de la personne, à un moment où elle termine sa peine (sa « dette à la société ») [carnet de terrain, juillet 2021] et se projette à l’extérieur comme membre le plus ordinaire possible de la société.
Ces éléments cumulés renvoient aux questions – non spécifiques – de la continuité de l’action publique et de sa cohérence interne dans des conditions d’urgence politique et d’exceptionnalisme, et semblent illustrer avec force les conséquences néfastes qu’ils peuvent avoir sur le temps plus long de l'institution et de ses usagers.
D’autres problématiques se posent lors de la sortie, dans la continuité des paradoxes relevés dans les paragraphes précédents, tels que le refus systématique des demandes d’aménagement de peine malgré leur possibilité juridique et leur approbation par le juge d’application des peines antiterroristes, l’orientation en dispositifs types PAIRS [Hecker, 2021] et la question de l’institutionnalisation des parcours, la création de mesures judiciaires spécifiques (les mesures de sûreté, une peine après la peine ?) ou encore les mesures administratives (MICAS) et leurs effets sur la réinsertion. Autant d’éléments qui ne seront pas développés ici, mais qui soulèvent autant de questions à propos de leurs effets sur la possible réintégration des personnes détenues condamnées pour faits de terrorisme.
Conclusion
Les problèmes de réinsertion en sortie de détention sont considérables et anciens en France, quels que soient les faits commis 8. Toutefois, les diffficultés auxquelles se heurte la population concernée par la lutte contre la radicalisation violente semble en constituer le paroxysme. Si les dispositifs de lutte contre la radicalisation de l’administration pénitentiaire semblent répondre globalement à ses deux premiers objectifs (la gestion de la détention, notamment face aux risques de violence et de prosélytisme, et la sécurité du personnel et des personnes codétenues), il semble ainsi difficile de l’affirmer pour le troisième, soit la « sécurité de la société par une préparation active des conditions de libération » [Assemblée nationale, 2021, p. 3]. En effet, quelle place peut être laissée à des dispositifs de prise en charge et d’aide à la réinsertion dans un cadre institutionnel sécuritaire guidé par l’injonction au « zéro risque » (Chantraine, Scheer, 2021) ? Et alors que ces dispositifs existent, portés par des professionnels comme par des structures spécialisées, quel engagement des PPSMJ peut être attendu dans un projet de réintégration sociale avec une socialisation carcérale de haute sécurité, dans des dispositifs guerriers qui construisent ou renforcent un processus d’ennemisation ?
Les personnes détenues les plus susceptibles de passer à l’acte violent et les plus fermées à la prise en charge ne sont pas à négliger, et ce, pour la sécurité de tous. Mais elles demeurent minoritaires, d'après le terrain effectué, les professionnels de terrain parvenant dans la plupart des cas à entreprendre des prises en charge de ces personnes, notamment celles qui sont en détention ordinaire. De ce fait, un recours à des dispositifs ultra-sécuritaires de façon systématique ne semble pas permettre un désengagement de la violence, mais plutôt reporter par la contrainte physique et institutionnelle une problématique de façon indéterminée, en la complexifiant et en la renforçant avec le temps et les interactions institutionnelles. Le principe d’individualisation de la peine, pilier du système judiciaire français, a donc tout intérêt à être mis en œuvre par l’institution, qui a déjà les compétences internes pour le faire. Si cet article ne peut pas aborder de façon exhaustive cette thématique et ces enjeux, j’espère proposer des éléments de réflexion pour une approche pragmatique du sujet, tout en étant consciente que bien d’autres travaux seront nécessaires pour suivre les effets à plus long terme de ces dispositifs, sur les personnes comme sur l’institution.
Bibliographie
Bonelli L., Carrie F., 2018, La fabrique de la radicalité, Paris, Le Seuil, 312 p.
Chantraine G., Scheer D., 2022, « Stratégies, ruses et dissimulations dans les « quartiers d’évaluation de la radicalisation » (QER) – France », Déviance et Société Vol. 46, n°3, p. 375‑407.
Chantraine G., Scheer D., 2021, « Performing the Enemy? No-Risk Logic and the Assessment of Prisoners in “Radicalization Assessment Units” in French Prisons ». Punishment & Society 23, n°2, p. 260‑280.
Chantraine G., Scheer D., Depuiset M.-A., 2018, « Enquête sociologique sur les ``quartiers d’évaluation de la radicalisation’’ dans les prisons françaises », 2018, 198 p.
Hecker M., 2021, « Djihadistes un jour, djihadistes toujours ? Un programme de déradicalisation vu de l’intérieur ». Focus stratégique, 82 p.
Sèze R., 2019, Prévenir la violence djihadiste: les paradoxes d’un modèle sécuritaire, Paris, Le Seuil, 213p.
Notes
(1) Les données de terrain utilisées dans cet article proviennent d’une recherche de doctorat financée par le COSPRAD (2019-2022), qui a permis une ethnographie de trois ans au sein de l’administration pénitentiaire, la consultation du dossier de plusieurs dizaines de personnes sous main de justice concernées par ces thématiques et l’accès à la littérature grise de l’administration pénitentiaire (doctrines, notes de service, etc.).
(2) Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « Prise en charge pénitentiaire des personnes “radicalisées” et respect des droits fondamentaux », Présentation du rapport, janvier 2020, p. 4.
(3) Observatoire international des prisons, Section française, Analyses, « Pour les plus radicaux : l’isolement, et après ? », 11 décembre 2020 ; Sénat, travaux parlementaires, Rapports et documents de travail, Rapports d’information, Délégation parlementaire au renseignement – rapport d’activité 2019-2020, Rapport no 506 (2019-2020), déposé le 11 juin 2020, « II. Le renseignement pénitentiaire au cœur du dispositif de lutte contre le terrorisme ».
(4) Voir les nombreux rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté sur ce sujet.
(5) Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport de visite, 31 mai au 4 juin et 7 au 9 juin 2021 – 3e visite, Centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville (Meurthe-et-Moselle).
(6) Cette situation risque de ne pas changer, notamment depuis l’assassinat d’Yvan Colonna en détention par une personne détenue condamnée pour AMT pendant son service d’auxiliaire à la maison centrale d’Arles.
(7) Telle qu’elle est théorisée par entre autres Loïck M. Villerbu, Pascal Le Bas ou Philippe Genuit.
(8) Voir sur le sujet le rapport du Conseil économique, social et environnemental de novembre 2019.
Derrière cet article

