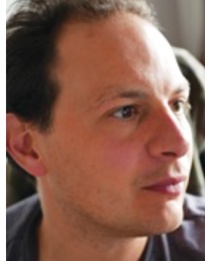Cet article a été écrit par Nicolas Amadio, maître de conférences en sciences sociales à l'Université de Strasbourg. Il est issu du n°58 des Cahiers de la sécurité et de la justice.
L’objectif de cette contribution est de mettre en perspective l’enjeu de décloisonnement qui émerge pour les chercheurs et les praticiens confrontés à la problématique de la réintégration sociale dans le cas de l’extrémisme violent. Elle se fonde sur des données exploratoires recueillies pour le programme de recherche ANR TROC (Terrorists Reintegration in Open Custody – Réintégration sociale des personnes condamnées pour terrorisme en milieu ouvert) et issues de la littérature internationale en matière de réintégration sociale et de désengagement appliquée aux domaines du terrorisme et de la radicalisation, ainsi que d’entretiens semi-directifs conduits avec des acteurs de la sécurité, de la justice, du monde associatif et avec des personnes condamnées pour terrorisme. Ces premières données montrent que la réintégration sociale nécessite d’articuler des pratiques professionnelles de domaines différents et de prendre en compte la dimension collective du processus de désengagement en s’intéressant au rôle des familles, des communautés et du voisinage. Aussi bien du point de vue des professionnels que des personnes impliquées, la réintégration sociale invite à aller au-delà des pratiques de désectorisation (dans le domaine de la sécurité), de réhabilitation (dans le domaine de la probation) et de réinsertion (dans le domaine socio-économique).
Mots-clés : réintégration sociale, décloisonnement, terrorisme, radicalisation, désengagement.
Introduction
En France, les approches par lesquelles chercheurs et praticiens ont appréhendé les questions relatives au terrorisme se sont le plus souvent inscrites dans une logique de réaction face à l’évolution des menaces et des risques, plutôt que dans une logique d’anticipation et de prévention (Sèze, 2019 : 19-22). Au cœur de ces approches, la notion de radicalisation semble renvoyer à des développements récents. En réalité, son usage est devenu de plus en plus fréquent dès les attaques du 11 septembre 2001 et s’est rapidement étendu à des problématiques sociopolitiques disparates (Sedgwick, 2010). Il s’est encore accru à partir de 2015 avec l’émergence progressive de candidats au djihad souhaitant rejoindre la Syrie, phénomène renforçant la menace croissante d’un terrorisme intérieur de nouvelle génération (Hecker, Tenenbaum, 2021).
La question de la réintégration sociale des personnes condamnées pour terrorisme et, plus largement, des personnes « radicalisées », s’inscrit dans cette logique : son importance a été mise en exergue par la constatation d’une inversion des courbes entre le nombre de condamnés pour terrorisme et suspectés de radicalisation qui sont détenus en milieu fermé et celui des détenus en milieu ouvert (Amadio et al., 2021). Leur réintégration devient, ex tempore, un enjeu social et politique majeur en France. Cela ne signifie pas que rien n’a été concrètement fait, ni étudié, mais que les approches de la radicalisation privilégiées par les praticiens et les chercheurs français ont, jusqu’ici, été peu attentives aux enjeux de réintégration sociale.
à l’instar des travaux internationaux (Borum, 2012), avant de s’intéresser aux programmes d’évaluation et de déradicalisation (Baker-Beall, 2015), les recherches françaises ont porté sur les processus et les facteurs de radicalisation (Khosrokhavar, 2017 ; Crettiez et Bilel, 2017 ; Marlière, 2021), de façon plus ou moins liée aux motivations et aux profils des personnes dites radicalisées (Khosrokhavar, 2015 ; Benslama, 2019 ; Bonelli et Carrié 2018 ; Truong, 2017 ; El Karoui et Hodayé, 2021). Parallèlement, des témoignages, des enquêtes et des travaux universitaires (Alber, Cabalion, Cohen, 2020) ont essayé de rendre compte des premières expériences de « déradicalisation » et de leurs échecs (Bouzar, 2018 ; Bronner, 2019 ; Boucher, 2021, Mansouri et Harrach, 2021 ; Sèze, 2019, Hecker, 2021). Ces expériences ont d’abord puisé dans le répertoire de la lutte contre l’emprise sectaire, alors relativement développée sur un plan pratique et scientifique. Elles ont ensuite gagné en autonomie, participant à l’élaboration d’un domaine d’intervention spécifique. On le désigne par convention en fonction du nom que l’on prête à l’approche majoritaire, sans toujours s’attacher plus avant aux significations particulières de chacun des termes employés. On parle ainsi de « déradicalisation », de « lutte ou de prévention contre la radicalisation », de « lutte contre l’extrémisme violent », de « prise en charge de radicalisation menant à la violence », ou encore – plus récemment – de « désengagement de l’extrémisme violent ». On notera ainsi que, si la question du terrorisme n’est pas absente de ces réponses et de ces réflexions, elle reste le plus souvent reléguée à l’arrière-plan, notamment du fait d’une acception en termes de moyens d’action et de logiques géopolitiques qui tendent à la cantonner aux spécialistes du domaine de la sécurité et de la défense. On peut d’ailleurs y voir une première difficulté à concevoir et à mettre en œuvre une approche intégrée des phénomènes de radicalisation et de terrorisme, dans leurs dimensions socio-psychologique et sécuritaire, et ce, aussi bien au niveau de l’anticipation que du traitement des menaces et des risques.
En écho aux évolutions juridiques relatives à la menace et aux attaques terroristes, des recherches ont également été menées quant à la question du régime d’exception et à l’articulation entre actions administratives et judiciaires (Gautron, Monniaux, 2016 ; Alix et Cahn, 2017 ; Codaccioni, 2015 ; Sakhi, 2018). Progressivement, on a vu les débats concernant l’aspect religieux, politique et socio-économique être happés par la polarisation entre les positions de Gilles Kepel (2015) et d’Olivier Roy (2016). L’opposition parfois réductrice des débats entre islamisation de la radicalité et radicalisation de l’islam semble avoir constitué un point d’achoppement intellectuel entre des acteurs, universitaires et praticiens, qui ont pu avoir le sentiment de devoir prendre position, cette dernière donnant lieu à des lectures politiques dans l’espace médiatique (Hedges, 2017 ; Dumoulin, 2018 ; Boily, 2019).
En pratique, parallèlement à ces recherches, des groupes de travail, des dispositifs et des programmes expérimentaux de « prise en charge » ont été mis en œuvre de façon plus ou moins coordonnée, sur l’ensemble du territoire national. Certaines actions ont participé à la sensibilisation des professionnels et à la prévention primaire. D’autres ont poursuivi des objectifs de prévention secondaire ou tertiaire (Amadio, 2019). Des programmes de prise en charge de personnes condamnées pour des faits de terrorisme ont été entrepris par des acteurs locaux (c’est le cas du PJPDR, le programme judiciaire de prévention des dérives radicales, porté par la cour d’appel de Colmar présenté dans ce numéro) ou développés dans une perspective nationale (c’est le cas du programme RIVE, rapidement refondé dans le programme PAIRS, le programme d’accueil individualisé et de réaffiliation sociale). Cependant, ces différentes expérimentations n’ont donné lieu ni à la production de données probantes ni à des évaluations structurées. L’échec de l’implémentation du processus d’évaluation standardisé initialement prévu par les concepteurs du programme RIVE témoigne de la difficulté à intégrer une culture de l’évaluation dans les pratiques françaises (Herzog-Evans et Benbouriche, 2019). Il demeure ainsi difficile de définir à quelles orientations (déradicalisation, désengagement, désistance) répondent ces prises en charge et de connaître leurs effets sur les bénéficiaires. De plus, bien que ces actions aient contribué à la production de savoirs, d’expérience et de compétences (Guzniczak, 2017), ces derniers ont pour l’instant été peu explorés et confrontés à la littérature internationale.
Le constat n’est pas le même en ce qui concerne les recherches internationales (Raets, 2021) et les pratiques internationales de lutte contre l’extrémisme violent et de contre-terrorisme. Ces dernières permettent de poser les jalons d’une caractérisation de la réintégration sociale en matière d’extrémisme violent (v. introduction de ce numéro) et en confrontant les premiers éléments d’enquête de terrain, d’en faire émerger les principaux enjeux. Dans leurs travaux, Dean et Feve (2020) reprennent par exemple la définition proposée par l’Office de lutte contre les drogues et le crime des Nations unies. La réintégration sociale y désigne « le processus par lequel une personne condamnée pour des faits relevant de l’extrémisme violent sort d’incarcération pour rejoindre la société 1 » (UNODC, 2016, p. 142). Une telle définition semble toutefois sacrifier la complexité du processus à l’opérationnalité. Comme le souligne Glazzard (2022, p. 4), « la littérature sur le terrorisme et l’extrémisme violent fait peu de cas pour conceptualiser la réintégration au-delà des déclarations plutôt circulaires selon lesquelles elle implique l’adoption d’un rôle et d’une identité “prosociaux”. À quelques exceptions près, la plupart des études sur le désengagement des extrémistes violents supposent que la réintégration se produit (si tant est qu’elle se produise) comme une conséquence du désengagement, et en restent là. » On trouvera cependant des caractérisations qui, tout en restant assez larges, s’avèrent plus précises. Par exemple, pour Bell, Buttler et Lawther (2021) la notion de réintégration sociale désigne à la fois une période, celle de la transition entre la prison et le retour à la société – qui comprend donc le moment de la libération – et les expériences qui sont liées à cette transition : « la réintégration est donc considérée comme un processus qui implique non seulement des changements pratiques, mais aussi des changements symboliques et sociaux plus larges de “pardon, d’acceptation… de rédemption et de réconciliation” (Maruna, 2006, p. 28) » (Bell, Buttler et Lawther 2021, p. 7).
Cette courte définition est suffisante pour montrer que la réintégration sociale en matière d’extrémisme violent désigne un phénomène processuel et expérienciel qui concerne les acteurs individuels et collectifs qui composent la société. On comprend que le processus de réintégration sociale possède des enjeux propres, dont la compréhension nécessite de renouveler les pratiques professionnelles et universitaires. Les travaux internationaux et les premières données empiriques issues de la recherche TROC 2 mettent en perspective le fait que, pour faire face à ces enjeux, praticiens et universitaires sont confrontés à la nécessité de décloisonner leurs approches. L’objectif de cette contribution est de définir ce que l’on entend par « décloisonnement ». Nous verrons ainsi que, aussi bien du point de vue des professionnels que de celui des bénéficiaires impliqués, la réintégration sociale invite à aller au-delà des pratiques de désectorisation (dans le domaine de la sécurité), de réhabilitation (dans le domaine de la probation) et de réinsertion (dans le domaine socio-économique). Elle implique d’articuler des pratiques professionnelles issues de ces différents domaines de manière à ce que ce ne soit pas une simple juxtaposition d’activités, mais bien de développement de pratiques coordonnées impliquant la participation de collectifs sociaux (famille, proches, communauté et réseaux sociaux). L’attention ainsi portée à la dimension collective du processus de réintégration sociale en matière d’extrémisme violent invite également les chercheurs à se mettre à distance de la notion de « radicalisation » afin de mieux prendre en compte les subcultures familiales, communautaires et collectives censées réintégrer les personnes condamnées.
Décloisonner pour aller au-delà de la désectorisation et de la réhabilitation
En 2014, Marc Sageman concluait un article dans lequel il s’interrogeait à propos de « la stagnation » des recherches américaines sur le terrorisme par ces mots : « We have a system of terrorism research in which intelligence analysts know everything but understand nothing, while academics understand everything but know nothing. » En 2022, qu’en est-il de la situation française ? Le contexte français est certes bien différent, aussi bien du point de vue culturel et légal que du système de sécurité intérieure et de l’organisation de la recherche. Pourtant, depuis les attentats du 11 septembre 2001, les réponses des États occidentaux face à la menace terroriste tendent à s’homogénéiser. Ainsi, la critique énoncée par Sageman en 2014 semble faire écho à une partie des difficultés rencontrées par les acteurs de la sécurité et de la recherche dans leurs tentatives respectives d’analyser les problématiques du terrorisme. Quels que soient les contextes, un même constat s’impose quant aux réponses à la menace terroriste : la nécessité d’articuler des compétences et des expertises plurielles. Pour désigner cette nécessité, nous proposons d’utiliser le terme « décloisonnement » pour deux principales raisons. La première est qu’on le retrouvera le plus souvent sous celui de « decompartmentalisation » dans la littérature internationale de langue anglaise. Or, si l’on peut trouver des références au terme « décompartementalisation » dans des textes français, il ne trouve pas d’entrée dans les dictionnaires, comme le Trésor de la langue française informatisé. Il peut ainsi s’agir d’un emprunt à la langue anglaise. Comme l’indique le TFLi, utilisé au sens figuré, le verbe « décloisonner » signifie « supprimer les cloisons d’ordre administratif ou psychologique qui empêchent les relations entre deux ou plusieurs disciplines intellectuelles, deux ou plusieurs groupes humains, organismes ou pays ». Ce sens figuré convenant à notre propos, nous conserverons donc l’usage du verbe existant « décloisonner » et de son substantif « décloisonnement ». La seconde raison est qu’un autre terme proche, « désectorisation », est fréquemment utilisé dans le domaine des politiques publiques de sécurité et de défense. Cependant, ce que nous désignons par « décloisonnement » ne recouvre pas totalement le sens habituellement donné au mouvement de désectorisation dans l’analyse des politiques publiques.
Logique inscrite dans la continuité de la désectorisation des politiques de défense et de sécurité
En 2014, Marc Sageman concluait un article dans lequel il s’interrogeait à propos de « la stagnation » des recherches américaines sur le terrorisme par ces mots : « We have a system of terrorism research in which intelligence analysts know everything but understand nothing, while academics understand everything but know nothing. » En 2022, qu’en est-il de la situation française ? Le contexte français est certes bien différent, aussi bien du point de vue culturel et légal que du système de sécurité intérieure et de l’organisation de la recherche. Pourtant, depuis les attentats du 11 septembre 2001, les réponses des États occidentaux face à la menace terroriste tendent à s’homogénéiser. Ainsi, la critique énoncée par Sageman en 2014 semble faire écho à une partie des difficultés rencontrées par les acteurs de la sécurité et de la recherche dans leurs tentatives respectives d’analyser les problématiques du terrorisme. Quels que soient les contextes, un même constat s’impose quant aux réponses à la menace terroriste : la nécessité d’articuler des compétences et des expertises plurielles. Pour désigner cette nécessité, nous proposons d’utiliser le terme « décloisonnement » pour deux principales raisons. La première est qu’on le retrouvera le plus souvent sous celui de « decompartmentalisation » dans la littérature internationale de langue anglaise. Or, si l’on peut trouver des références au terme « décompartementalisation » dans des textes français, il ne trouve pas d’entrée dans les dictionnaires, comme le Trésor de la langue française informatisé. Il peut ainsi s’agir d’un emprunt à la langue anglaise. Comme l’indique le TFLi, utilisé au sens figuré, le verbe « décloisonner » signifie « supprimer les cloisons d’ordre administratif ou psychologique qui empêchent les relations entre deux ou plusieurs disciplines intellectuelles, deux ou plusieurs groupes humains, organismes ou pays ». Ce sens figuré convenant à notre propos, nous conserverons donc l’usage du verbe existant « décloisonner » et de son substantif « décloisonnement ». La seconde raison est qu’un autre terme proche, « désectorisation », est fréquemment utilisé dans le domaine des politiques publiques de sécurité et de défense. Cependant, ce que nous désignons par « décloisonnement » ne recouvre pas totalement le sens habituellement donné au mouvement de désectorisation dans l’analyse des politiques publiques.
Réhabilitation, réinsertion, réintégration
En 2014, Marc Sageman concluait un article dans lequel il s’interrogeait à propos de « la stagnation » des recherches américaines sur le terrorisme par ces mots : « We have a system of terrorism research in which intelligence analysts know everything but understand nothing, while academics understand everything but know nothing. » En 2022, qu’en est-il de la situation française ? Le contexte français est certes bien différent, aussi bien du point de vue culturel et légal que du système de sécurité intérieure et de l’organisation de la recherche. Pourtant, depuis les attentats du 11 septembre 2001, les réponses des États occidentaux face à la menace terroriste tendent à s’homogénéiser. Ainsi, la critique énoncée par Sageman en 2014 semble faire écho à une partie des difficultés rencontrées par les acteurs de la sécurité et de la recherche dans leurs tentatives respectives d’analyser les problématiques du terrorisme. Quels que soient les contextes, un même constat s’impose quant aux réponses à la menace terroriste : la nécessité d’articuler des compétences et des expertises plurielles. Pour désigner cette nécessité, nous proposons d’utiliser le terme « décloisonnement » pour deux principales raisons. La première est qu’on le retrouvera le plus souvent sous celui de « decompartmentalisation » dans la littérature internationale de langue anglaise. Or, si l’on peut trouver des références au terme « décompartementalisation » dans des textes français, il ne trouve pas d’entrée dans les dictionnaires, comme le Trésor de la langue française informatisé. Il peut ainsi s’agir d’un emprunt à la langue anglaise. Comme l’indique le TFLi, utilisé au sens figuré, le verbe « décloisonner » signifie « supprimer les cloisons d’ordre administratif ou psychologique qui empêchent les relations entre deux ou plusieurs disciplines intellectuelles, deux ou plusieurs groupes humains, organismes ou pays ». Ce sens figuré convenant à notre propos, nous conserverons donc l’usage du verbe existant « décloisonner » et de son substantif « décloisonnement ». La seconde raison est qu’un autre terme proche, « désectorisation », est fréquemment utilisé dans le domaine des politiques publiques de sécurité et de défense. Cependant, ce que nous désignons par « décloisonnement » ne recouvre pas totalement le sens habituellement donné au mouvement de désectorisation dans l’analyse des politiques publiques.
De la (dé)radicalisation au désengagement : la dimension collective de la réintégration sociale
La nécessité du décloisonnement à laquelle font face les acteurs confrontés à la question de la réintégration sociale fait à son tour émerger l’importance de la prise en compte de la dimension collective des processus auxquels il est fait référence par les chercheurs. Pour comprendre en quoi le décloisonnement fait émerger la dimension collective, il convient de prendre du recul par rapport aux usages en ce qui concerne la « (dé)radicalisation », comparativement à d’autres notions comme celles de désistance (Polaschek, 2016 ; Shapland et al., 2016) et de désengagement (Altier, 2020 ; Raets, 2022). S’appuyer sur les notions de désengagement et de désistance permet de prendre en compte des dimensions propres au processus de réintégration sociale et encore peu étudiées par les travaux français, particulièrement sa dimension collective (groupes sociaux, familles, communauté, voisinage, quartier, etc.) (Ferret et Khosrokhavar, 2022).
Le décloisonnement de la notion de radicalisation
Du point de vue universitaire, d’aucuns ont souligné que « le terme de radicalisation, en forçant le regard sur la dimension processuelle de l’action, en évacuant la fausse problématique du basculement inexpliqué et en refusant toute recherche centrée exclusivement sur les causes, est une notion au potentiel heuristique certain » (Crettiez, 2016: 727). Il faut cependant reconnaître qu’en dehors du monde universitaire, le terme « radicalisation » a également pu servir « d’opérateur au glissement du registre de l’adversaire politique à celui de l’ennemi, voire du terroriste » (Guibet-Lafaye, 2019 : 3), notamment dans la confusion d’usage qu’il entretient avec la notion de terrorisme. On peut ajouter à cela que l’usage du terme « radicalisation » et de l’adjectif « radicalisé » tend à proposer une approche certes processuelle, qui reste toutefois centrée sur l’individu, tandis que la réintégration sociale appelle à la prise en compte de dimension collective ou communautaire. En effet, Guibet Lafaye et Rapin (2017, p. 140) soulignent : « L’individualisation du contenu signifiant de la notion de radicalisation, amorcée dans la qualification des mouvements sociaux, s’accomplit avec le registre terroriste et trahit implicitement la prévalence d’une approche subjectiviste et psychologisante de cet univers. À travers l’évocation de ces phénomènes s’opère une transposition de la radicalisation comme processus collectif à celle d’un processus individuel. » Ainsi, du point de vue de la réintégration sociale, l’usage du terme apparaît problématique.
Les concepts de désistance et de désengagement semblent pouvoir répondre aux limites liées à l’usage du terme de (dé)radicalisation, notamment dans la mesure où ils permettent d’intégrer la dimension collective inhérente au processus de réintégration sociale (Polaschek, Devon, 2016 ; Shapland, Farrall et Bottoms, 2016). À l’instar des expériences observées en Allemagne (Baaken et al., 2020), les pratiques socio-judiciaires françaises de la « déradicalisation » comprise au sens large, c’est-à-dire visant un objectif de réintégration sociale, semblent osciller entre la poursuite de différents objectifs. Les premières observations de terrain issues de la recherche TROC tendent pour le moment à les regrouper sous trois catégories qui recoupent les évaluations internationales : la déradicalisation (au sens d’un travail cognitif sur les croyances), la désistance (visant la sortie de la délinquance et rejoignant la lutte contre la récidive) et le désengagement (de la violence, mais aussi des groupes de pairs combattants). Leur présence simultanée dans les programmes traduit moins une poursuite explicite et à hauteur égale des objectifs qui les sous-tendent que l’évolution de l’appréhension sociopolitique des questions de radicalisation et de terrorisme. L’oscillation des programmes entre ces trois catégories résulte des réponses coup par coup à la menace terroriste et aux lectures de la radicalisation.
Cependant, on peut noter que si la dimension collective est transversale à ces trois catégories, elle est nettement plus prégnante dans les approches de désengagement (Altier, Thoroughgood et Horgan, 2014) que dans les approches de désistance (qui font appel à des ressorts criminologiques plus classiques de la réhabilitation) et, à plus forte raison, de déradicalisation (qui visent plus explicitement des changements idéologiques au moyen d’interventions psycho-cognitives) (Jensen et al., 2020). Pour autant, une utilisation plus fréquente de la notion de désengagement dans les programmes exprime-t-elle une attention plus soutenue à la question de la réintégration sociale ? Le constat fait par les autorités politiques et les acteurs de la chaîne pénale d’un inversement de la courbe des détentions en milieu fermé et milieu ouvert des personnes condamnées pour terrorisme le laisserait supposer. Il est toutefois difficile de dire si cette attention plus soutenue aux processus de désengagement s’accompagne d’une meilleure prise en compte de la dimension collective du processus de réintégration sociale. Pour cela, il faudrait pouvoir savoir dans quelle mesure les familles, les proches et les collectifs d’appartenance (communauté, voisinage) sont ou non impliqués dans le processus de réintégration sociale. Pour le moment, les explorations de terrain montrent encore peu d’initiatives de ce type. Bien que certaines expériences soient réalisées, la plupart des dispositifs s’appuient sur des dynamiques de réhabilitation et de réinsertion sociale déjà maîtrisées, consistant à développer des conduites prosociales et à permettre l’acquisition de ressources socio-économiques (emploi, habitat). Viser la dimension collective de la réintégration sociale supposerait d’ajouter à ces modèles d’intervention une plus grande implication des familles, des proches et du réseau relationnel de quartier, c’est-à-dire de les adapter à des caractéristiques socioculturelles et à des environnements communautaires spécifiques (Gunaratna, 2017). Sur ce point, on pourra se demander si l’évolution de la réponse politique en matière de prévention de la radicalisation vers la lutte contre le séparatisme ne risque pas d’entrer en contradiction avec la nécessité de prendre en compte les collectifs dans le processus de réintégration sociale, par exemple en accentuant une confusion déjà présente en France entre « communauté » et « communautarisme » (Amadio et Sarg, 2021).
Prendre en compte les collectifs et les subcultures de réintégration
Comme le souligne Reats (2021, p. :28), « les différences entre le désengagement extrémiste et la désistance criminelle sont des différences de degré, et non de nature ». En effet, d’un point de vue criminologique, la constatation de taux élevés de récidive dans la plupart des pays occidentaux (Maruna, Immarigeon et LeBel, 2011 ; Henneguelle et Monnery, 2017 ; Kensey et de Buryin, 2017) a amené à étudier les processus de désistance durant la transition de la prison à la société, cette période constituant une période particulièrement problématique (Weaver, 2015 ; Maruna, 2017 ; Leverentz, 2022). Bien que l’amplitude du processus de réintégration sociale reste à déterminer, on peut s’attendre à ce que la période de transition de la prison à la société (laquelle période peut inclure une phase probatoire elle-même conçue comme transitoire) soit déterminante en matière de désistance et de désengagement. Cependant, la plupart des recherches qui se sont intéressées aux obstacles qui peuvent s’accumuler durant cette période et affecter négativement les processus de désistance se sont concentrées sur les facteurs de risque et les expériences individuelles en matière de réhabilitation et de réinsertion (Visher, 2015). De sorte que notre compréhension de la façon dont des facteurs contextuels locaux peuvent influencer le processus de réintégration sociale reste finalement limitée au niveau criminologique général (Fox, 2015 ; Graham et McNeill, 2017), mais également en matière de réintégration dans le cadre de l’extrémisme violent. Certes, on peut être d’accord avec Reats (2021, p. 27) lorsqu’elle conclut que « de nombreuses différences entre l’extrémisme violent et la criminalité ordinaire ne sont pas plus problématiques que les différences entre la criminalité ordinaire et des types de délits plus spécialisés, comme la criminalité organisée ou la violence des gangs. Même si chacun d’entre eux possède ses propres caractéristiques et requiert des connaissances et des réponses spécialisées, ils sont toujours considérés comme des comportements criminels. » Cependant, son travail met également en lumière que poser la question de la réintégration dans le cadre de l’extrémisme violent nécessite une forme de décloisonnement à l’intérieur du domaine criminologique. La combinaison entre les approches en matière de DDR (disarmament, demobilization, and reintegration) et de VEDR (violent extremist disengagement and reintegration) [Altier, 2021] en constitue un exemple. En effet, si les recherches en DDR s’appliquent principalement à des situations de conflits ou de postconflits armés, elles ont produit une importante littérature théorique et pratique en matière de réintégration d’anciens combattants au sein de collectifs sociaux qui peuvent inspirer le domaine des VEDR. L’articulation entre les dimensions individuelles et collectives dans des modèles catégorisés par Reats (2021 : 2) comme factoriels (push-pull factors), de phase (processuel) et d’identité (changement d’identité) en est un autre. En effet, si la façon dont les normes et les valeurs de groupes restreints (familles, communauté, réseaux relationnels) et d’environnements circonscrits (quartier, voisinage) peuvent influencer l’entrée dans la criminalité et par la suite les opportunités criminelles est une question criminologique récurrente (Shaw et McKay, 1942 ; Sampson., 2013 ; Intravia et al., 2014 ; Sutherland et al., 2013 ; Hipp et Wickes, 2016 ; Walker, 2017), on connaît moins la manière dont les subcultures et les liens collectifs peuvent peser sur le désengagement, notamment pendant la période de réintégration sociale. L’action de facteurs contextuels (inégalités, cultures, ethnicité, religion) sur la désistance et la manière dont des liens collectifs de voisinage permettent des contrôles efficaces (collective efficacy) par la surveillance et l’entre-aide ont fait l’objet de travaux récents (Sampson, 2013 ; Segev, 2020), mais restent à développer en ce qui concerne le désengagement de l’extrémisme violent. Or, l’articulation entre les modèles factoriels, de phase et d’identité invite précisément à prendre en compte la façon dont la dimension collective peut constituer une ressource (ou une résistance) spécifique (mais non exclusive) en matière de désengagement de l’extrémisme violent.
Conclusion
à l’instar de Bell, Butler et Lawther (2021), il est important de chercher à analyser la façon dont les subcultures peuvent jouer un rôle dans le processus de réintégration sociale des personnes condamnées pour terrorisme. Pour ce faire, il convient de poursuivre le décloisonnement auxquels les professionnels et les chercheurs sont confrontés lorsqu’ils abordent la question de la réintégration sociale des personnes condamnées pour des faits de terrorisme. En effet, si ce décloisonnement apparaît comme une nécessité pratique, il ouvre également sur la dimension collective propre à la réintégration, car cette dernière s’adresse à la société et aux collectifs qui la composent, tout autant qu’à la personne condamnée. Chercheurs et professionnels doivent alors s’extraire d’un modèle de réhabilitation centré sur les capacités individuelles et d’une approche de la réinsertion sociale souvent réduite à l’acquisition de ressources socio-économiques (emploi, logement) pour investir les caractéristiques socio-culturelles des collectifs qui sont amenés à réintégrer les condamnés pour terrorisme. Comment ces collectifs affectent-ils l’exposition des personnes aux risques de récidive ? Comment façonnent-ils leurs expériences de réintégration sociale, c’est-à-dire la manière dont ils vivent leur retour parmi leur famille et leurs proches et dans les groupes sociaux ? Comment, au regard de leur réintégration sociale, perçoivent-ils finalement leurs appartenances à ces collectifs ? Dans quelle mesure peut-on les évaluer comme des ressources en matière de réintégration sociale ou, au contraire, comme des freins, et quelles en sont les principales dynamiques ?
Bibliographie
Alber A., Cabalion J. et Cohen V., 2020, Un impossible travail de déradicalisation, Érès.
Alix J. et Cahn O., 2017, « Mutations de l’antiterrorisme et émergence d’un droit répressif de la sécurité nationale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 4, 845-868.
Altier M. B., 2021, « Violent Extremist Disengagement and Reintegration. Lessons from Over 30 Years of DDR », Washington, D.C., RESOLVE Network.
Altier, M. B., Boyle, E. et Horgan, J., 2020, « Terrorist Transformations. The Link between Terrorist Roles and Terrorist Disengagement », Studies in Conflict and Terrorism, 45, 9, 125.
Altier M. B., Thoroughgood C. N. et Horgan J. G., 2014, « Turning away from terrorism: Lessons from psychology, sociology, and criminology », Journal of Peace Research, 51, 5, 647-661.
Amadio N., 2019, « Face à la radicalisation. Prévenir pour mieux protéger les mineurs », The Conversation.
Amadio N., 2022, « Shaping the subculture of human source intelligence within criminal units? Testing Intelligence Analysis Groups in the French Gendarmerie », Policing and Society, 33, 4, 429-448.
Amadio N., Benouriche M., Domingo B. et Sarg R., 2021, « Réintégrer les mis en cause pour terrorisme : derrière les incertitudes, des enjeux majeurs », The Conversation.
Amadio N. et Sarg R., 2021, « Société civile et justice restaurative », Revue des sciences sociales, 65, 90-193.
Baaken T., Korn J., Ruf M. et Walkenhorst D., 2020, « Dissecting Deradicalization. Challenges for Theory and Practice in Germany », International Journal of Conflict and Violence, 14, 2, 1-18.
Baker-Beall C. (dir.), 2015, Counter-Radicalisation. Critical Perspectives, Routledge.
Bartolucci V., 2017, « The Perils and Prospects of the French Approach to Counterterrorism », dans Scott Nicholas Romaniuk, Francis Grice, Daniela Irrera et Stewart Webb (dir.), The Palgrave Handbook of Global Counterterrorism Policy, Palgrave Macmillan, 437-458.
Bell S., Butler M. et Lawther C., 2021, « Desistance in Context: Understanding the Effects of Subculture on the Desistance Process During Reintegration », The British Journal of Criminology, 61, 3, 812-831.
Benslama F. (dir.), 2019, Le genre humain, 2, 61 : États de la radicalisation.
Boily F. 2019, « Le débat entre Gilles Kepel et Olivier Roy. Anatomie d’un désaccord », Frontières, 31, 1.
Bonelli L. et Carrié F., 2018, La Fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français, Le Seuil.
Borum R., 2012, « Rethinking Radicalizaron », Journal of Strategic Security, 4, 1-6.
Boucher M., 2021, L’enfance en danger face aux radicalités musulmanes. Représentations, pratiques, et ambivalences des intervenants sociaux, L’Harmattan.
Bouzar D., 2018, Français radicalisés. Enquête : ce que révèle l’accompagnement de 1 000 jeunes et de leur famille, L’Atelier.
Bronner G., 2019, Déchéance de rationalité, Grasset.
Calverley A., 2013, Cultures of Desistance. Rehabilitation, Reintegration and Ethnic Minorities. Routledge.
Cherney A. et Hartley J., 2017, « Community engagement to tackle terrorism and violent extremism: challenges, tensions and pitfalls », Policing and Society, 27, 7, 750-763,
Codaccioni V., 2015, Justice d’exception. L’État face aux crimes politiques et terroristes, CNRS éditions.
Crettiez X. et Bilel A., 2017, Soldats de Dieu. Paroles de djihadistes incarcérés, Fondation Jean-Jaurès/ L’Aube.
Crettiez X., 2016, « Penser la radicalisation. Une sociologie processuelle des variables de l’engagement violent », Revue française de science politique, 66, 709-727.
Daho G., 2019, « La désectorisation des politiques de sécurité. Le cas du recentrage interministériel du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale », Revue française d’administration publique, 171, 3, 651-667.
Dean D. et Feve S., 2020, « Coopérer avec la société civile pour réhabiliter et réintégrer les détenus extrémistes violents », Note d’orientation, Global Center on Cooperative Security.
Domingo B., 2020, Terrorisme. Prévenir et agir par l’action locale, Territorial éditions.
Duarte S., 2019, « La dimension religieuse appliquée au désengagement de l’idéologie violente : pistes de réflexion », Les Cahiers de la sécurité et de la justice, 46.
Ducol B., 2018, « Prévenir la radicalisation violente. Nouveaux habits d’une action publique à la française ? », Cahiers de la sécurité et de la justice, 46, 8-19.
Dumoulin, M., 2018, « Déconstruire la radicalisation. Implications et limites de la notion », Confluences Méditerranée, 105, 171-181.
El Karoui H. et Hodayé B., 2021, Les militants du djihad. Portrait d’une génération, Fayard.
Ferret J. et Khosrokhavar F. (dir.), 2022, Family and Jihadism. A Socio-Anthropological Approach to the French Experience, Routledge.
Fox K. J., 2015, « Theorising Community Integration as Desistance-Promotion », Criminal Justice and Behaviour, 42, 1, 82-94.
Galland O. et Muxel A., 2018, La tentation radicale. Enquête auprès des lycéens, Presses universitaires de France.
Gautron V. et Monniaux D., 2016, « De la surveillance secrète à la prédiction des risques. Les dérives du fichage dans le champ de la lutte contre le terrorisme », Archives de politique criminelle, 38, 1, 123-135.
Gill P. et Phythian M., 2018, « Developing intelligence theory », Intelligence and National Security, 33, 4, 467-471.
Glazzard, A., 2022, « Violent Extremist Disengagement and Reintegration. A Framework for Planning, Design and Evaluation of Programmatic Interventions », Studies in Conflict and Terrorism.
Graham H. et McNeill F., 2017, « Desistance. Envisioning Futures », dans P. Carlen et F. Ayres (dir.), Alternative Criminologies, Routledge, 433-451.
Guibet Lafaye C., 2019, « Radicalisation. De l’adversaire à l’ennemi », Regards sociologiques, 53-54, 169-192.
Guibet Lafaye C. et Rapin A., 2017, « La “radicalisation”. Individualisation et dépolitisation d’une notion », Politiques de communication, 8, 127-154.
Gunaratna, R., 2017, « Fighting Terrorism With Smart Power. The Role of Community Engagement and Terrorist Rehabilitation », dans Henning Glaser (dir.), Talking to the Enemy. Deradicalization and Disengagement of Terrorists, Nomos Verlagsgesellschaft, 67-89.
Guzniczak B., 2017, « Du côté de la prévention. De Valence à Marseille », Les Cahiers dynamiques, 2, 72, 67-75.
Habouzit, F., 2017, « L’usage de la notion de radicalisation dans le champ pénitentiaire », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 3, 587-606.
Hecker M et Tenenbaum E., 2021, La guerre de vingt ans. Djihadisme et contre-terrorisme au xxie siècle, Robert Laffont.
Hecker M., 2021, « Djihadistes un jour, djihadistes toujours ? Un programme de déradicalisation vu de l’intérieur », Focus stratégique, 102.
Hedges P., 2017, « Radicalisation. Examining a Concept, its Use and Abuse », Counter Terrorist Trends and Analyses, 9, 10, 12-18.
Henneguelle A. et Monnery B., 2017, « Prison, peines alternatives et récidive », Revue française d’économie, 32, 1, 169-207.
Herzog-Evans M. et Benbouriche M. (dir.), 2019, Evidence-Based Work with Violent Extremists International Implications of French Terrorist Attacks and Responses, Lexington Books.
Horgan J., Meredith K. et Papatheodorou K., 2020, « Does deradicalization work ? », dans D. M. D. Silva et M. Deflem (dir.), Radicalization and Counter-Radicalization (Sociology of Crime, Law and Deviance, vol. 25), Emerald Publishing Limited, 9-20.
Intravia J., Wolff, K. T., Stewart E. A. et Simons, R. L., 2014, « Neighbourhood-level Differences in Police Discrimination and Subcultural Violence. A Multilevel Examination of Adopting the Code of the Street », Journal of Crime and Justice, 37, 1, 42-60.
Jensen M., James P. et Yates E., 2020, « Contextualizing Disengagement. How Exit Barriers Shape the Pathways Out of Far-Right Extremism in the United States », Studies in Conflict and Terrorism, 46, 3, 1-29.
Bullock K. et Johnson P., 2018, « Police Engagement with Muslim Communities. Breaking Out, Breaking In, and Breaking Through », Policing and Society, 28, 8, 879-897.
Kearns E. M., 2020, « Exploring Officer Views of Community Policing in Counterterrorism », Police Practice and Research, 21, 1, 18-32.
Kensey A. et De Bruyin F., 2017, « 50 ans d’études quantitatives sur les récidives enregistrées », Travaux et Documents, no 86, Direction de l’Administration pénitentiaire.
Kepel G., 2015, Terreur dans l’Hexagone. Genèse du djihad français, Gallimard.
Khosrokhavar F., 2019, Radicalisation, Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
Khosrokhavar F., 2015, « Les trajectoires des jeunes jihadistes français », Études, 6, 33-44.
Khosrokhavar F., 2017, « Le nouveau djihadisme européen », Revue du MAUSS, 49, 1, 31-47.
Knight S. et Keatley D., 2020, « What Do We Know about Radicalization ? A Commentary on Key Issues, Findings and a Framework for Future Research for the Scientific and Applied Community », International Journal of Conflict and Violence, 14, 2, 1-7.
Lemieux F., 2018, Intelligence and State Surveillance in Modern Societies. An International Perspective, Emerald Publishing Limited
Leverentz A., 2022, Intersecting Lives. How Place Shapes Reentry, University of California Press.
McGarrell E. F., Freilich J. D. et Chermak S., 2007, « Intelligence-led policing as a framework for responding to terrorism », Journal of Contemporary Criminal Justice, 23, 2, 142-158.
Mansouri M. et Harrach Z., 2021, « Une clinique de la “radicalisation” », L’Évolution psychiatrique, 86, 1, 77-88.
Marlière E., 2021, La Fabrique sociale de la radicalisation. Une contre-enquête sociologique, Berger-Levrault.
Maruna S., 2006, « Who Owns Resettlement? Towards Restorative Re-integration », British Journal of Community Justice, 4, 2, 23-34.
Maruna S., 2017, « Desistance as a Social Movement », Irish Probation Journal, 14, 1, 5-20.
Maruna S., Immarigeon R. et LeBel T., 2011, « Ex-Offender Reintegration. Theory and Practice », dans S. Maruna et R. Immarigeon (dir.), After Crime and Punishment, Routledge, 3-27.
Mazerolle L., Cherney A., Eggins E., Hine L. et Higginson A., 2021, « Multiagency programs with police as a partner for reducing radicalisation to violence », Campbell Systematic Reviews, 17.
Mégie A. et Jossin A., 2016, « De la judiciarisation du renseignement. Le cas des procès de djihadistes », Revue Hermes, CNRS, novembre.
Micheron H., 2020, Le jihadisme français. Quartiers, Syrie, prisons, Gallimard.
Mythen G., 2012, « “No one speaks for us”. Security policy, suspected communities and the problem of voice », Critical Studies on Terrorism, 5, 3, 409-424.
Neumann P. et Kleinmann S., 2013. « How Rigorous Is Radicalization Research ? », Democracy and Security, 9, 4, 360‑382.
Perry S. et Jonathan-Zamir T., 2014, « Lessons from Empirical Research on Policing in Israel. Policing Terrorism and Police-Community Relationships », Police Practice and Research, 15, 2, 173-187.
Polaschek D. L., 2016, « Desistance and Dynamic Risk Factors Belong Together », Psychology, Crime and Law, 22, 1-2, 171-89.
Raets S., 2022, « Desistance, Disengagement, and Deradicalization. A Cross-Field Comparison », International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 1-38.
Ragazzi F., 2017, « Countering Terrorism and Radicalisation, Securitising Social Policy ? », Critical Social Policy, 37, 2, 163-179.
Lambert R. et Parsons T., 2017, « Community-Based Counterterrorism Policing. Recommendations for Practitioners », Studies in Conflict and Terrorism, 40, 12, 1054-1071.
Rougier B., 2020, Les territoires conquis de l’islamisme, Paris, PUF.
Rousseau C., Hassan G. et Oulhote Y., 2017, « And if there were another way out? Questioning the prevalent radicalization models », Canadian Journal of Public Health / Revue canadienne de santé publique, 108, 5-6, e633–e635.
Roy O., 2016, Le djihad et la mort, Le Seuil.
Sakhi M., 2018, « Terrorisme et radicalisation », Journal des anthropologues, 154-155, 161-181.
Sampson R. J., Morenoff J. D. et Gannon-Rowley T., 2002, « Assessing “Neighborhood Effects”. Social Processes and New Directions in Research », Annual Review of Sociology, 28, 443-478.
Sampson R. J., 2013, « The Place of Context. A Theory and Strategy for Criminology’s Hard Problems », Criminology, 51, 1, 1-31.
Sedgwick M., 2010, « The Concept of Radicalization as a Source of Confusion », Terrorism and Political Violence, 22, 4, 479-494.
Segev D., 2020, Desistance and Societies in Comparative Perspective, Routledge.
Sèze R., 2019, Prévenir la violence djihadiste. Les paradoxes d’un modèle sécuritaire, Le Seuil.
Shapland J., Farrall S. et Bottoms A., 2016, Global Perspectives on Desistance, Routledge.
Shaw, C. R. et McKay H. D., 1942, Juvenile Delinquency and Urban Areas, University of Chicago Press.
Sheptycki J., 2013, « To Go Beyond the Cycle of Intelligence-Led Policing », dans Mark Phythian (dir.), Understanding the Intelligence Cycle, Routledge, 99-118.
Silk P. D., Spalek B. et O’Rawe M., 2013, Preventing Ideological Violence. Communities, Police and Case Studies of « Success », Palgrave Macmillan.
Simonet J.-C., 2002, « Insertion », dans Jean-Pierre Fragnière et Roger Girod (dir.), Dictionnaire suisse de politique sociale, Réalités sociales, 215-216.
Sutherland A., Brunton-Smith I. et Jackson J., 2013, « Collective Efficacy, Deprivation and Violence in London », British Journal of Criminology, 53, 6, 1050-1074.
Tilley N., 2003, « Community policing, problem-oriented policing and intelligence-led policing », dans Tim Newburn (dir.), Handbook of policing, Willan, 311-339.
Truong F., 2017, Loyautés radicales. L’islam et les « mauvais garçons » de la nation, La Découverte, Paris.
Visher C. A., 2015, « Re-Entry and Reintegration After Incarceration », International Encyclopaedia of the Social and Behavioural Sciences, 2, 1, 61-66.
Walker J., 2017, Social, Ecological and Environmental Theories of Crime, Routledge.
Weaver B., 2015, Offending and Desistance. The Importance of Social Relations, Routledge.
Office des Nations unies contre la drogue et le crime, 2016, « Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of Radicalization to Violence in Prisons », Criminal Justice Handbook Series [« Manuel sur la gestion des détenus extrémistes violents et la prévention de la radicalisation violente en milieu carcéral », Série de manuels sur la justice pénale, 2017].
Derrière cet article