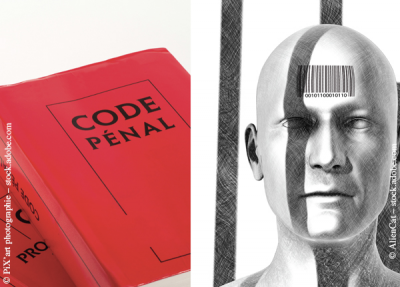
Cet article a été écrit par Pierre Lamothe, psychiatre, médecin légiste, ancien chef de pôle hospitalier et expert honoraire agréé par la Cour de cassation ; Sabine Mouchet, psychiatre, chef de service au pôle de psychiatrie légale du Centre hospitalier Le Vinatier, à Lyon ; et Philippe Vittini, psychiatre libéral, expert judiciaire et médecin coordonnateur dans le cadre de l'injonction de soins. Il est issu du 52e numéro des Cahiers de la sécurité et de la justice qui s'interroge sur la gestion des crimes complexes par l'institution judiciaire et les améliorations possibles.
Depuis presque trente ans déjà et l'arrivée du nouveau Code pénal en France, la notion de responsabilité pénale a évolué avec une précision symbolique et technique qui continue de laisser parfois les experts, le public, autant que les parties et les juridictions de jugement dans le doute ou au contraire dans des certitudes idéologiques appliquées sans vergogne. Au moment du dépôt du rapport, largement évoqué dans ce numéro, du groupe de travail coordonné par le procureur général Jacques Dallest sur les Cold cases (nous ne reprendrons pas ici tout ce que ce vocable réunit fort opportunément), un arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire Halimi-Traoré provoque émotion et réactions jusqu'à l'étranger dans les pays où la question de l'antisémitisme est particulièrement sensible. La Cour de cassation, en effet, rompant avec la jurisprudence pratiquement constante (au moins dans les Cold cases !) renvoyant un fauteur d'accident ou de crime en état d'ivresse devant la justice, a jugé en droit, tout en retenant le caractère antisémite du crime, qu'un jeune malien déjà condamné et habitué à la prise de toxiques était néanmoins irresponsable pénalement du fait de la bouffée délirante de l'auteur justifiait qu'il ne soit pas jugé car cela relevait de la stricte application de la loi, et le troisième qui considérait que Kobili Traoré s'était lui-même placé dans une situation où il était devenu meurtrier, en laissant libre cours dans le passage à l'acte à son hostilité antisémite et en facilitant sa perte de contrôle par la prise de haschich dont les effets n'avaient pu le surprendre vu son habitude du produit. S'il y a continuité entre la prise délibérée de toxique et l'état de perte du discernement par « trouble mental », ici la bouffée délirante, le contrôle existait initialement sur la prise de toxique délibérée et on revient à l'idée de ne pas accepter la notion d'une responsabilité qui soit « détaillée ». Même si l'un des experts de l'affaire a dit dans une interview – encore une – que ce n'était pas le cas à ses yeux parce que Traoré recherchait plutôt l'abrutissement que l'excitation dans sa prise habituelle. On rappellera à ce propos que les membres de la secte Haschichin, d'où est venu le mot « assassin », prenaient cette drogue pour se mettre en condition avant leurs crimes follement commandités par un gourou qui n'avaient rien à envier aux chefs terroristes islamistes d'aujourd'hui et consternait déjà chrétiens et musulmans.
Est-il possible de maintenir dans le champ de la clinique psychiatrique et d'elle seule l'appréciation de la capacité de discernement ainsi que de la capacité à contrôler ses actes de l'auteur d'un crime. Il s'agit là d'éléments centraux de la définition de la capacité à en répondre puisque leur intégrité entraîne la responsabilité pénale, selon l'article 122.1 du Code pénal en France, et que leur altération doit être prise en compte par les juridictions de jugement pour le prononcé de la peine et ses modalités d'exécution selon les dispositions du 2e alinéa de cet article 122.1 ? Faut-il remplacer l'alternative par une exigence de simultanéité de perte du contrôle et du discernement ?
Cette subdivision discernement et contrôle, issue des propositions du groupe III de la Commission des maladies mentales des années 1980 (Commission Pélissier) dont l'un d'entre nous était membre, devait lever l'ambigüité de l'état de démence ne correspondant plus du tout à une référence psychiatrique moderne et ne plus poser de problème dans le futur sur des évolutions nosologiques prévisibles tout en supprimant également toute référence à la circulaire Chaumier de 1905 et la notion de responsabilité atténuée en posant, comme le souhaitaient les philosophes et les sémiologues, la prémisse que la responsabilité est ou n'est pas, mais ne se divise pas. La suppression de la formule « il n'y a ni crime ni délit » devait surtout éliminer l'idée que le crime était sans conséquences, ce qui entraînait l'arrêt des mesures d'instruction, l'abandon des poursuites équivalant alors à l'abandon du suivi. Des années plus tard, dans les plus hautes sphères de la République, on trouvait encore que la notion de non-lieu permettait cette interprétation comme si le non-lieu (à poursuivre) signifiait quasiment « qu'il ne s'était rien passé ».
Sur les mêmes bases, dans le nouveau Code pénal Suisse de 2007, issu des propositions et pré-études du Conseil Fédéral pendant des années, la nécessité de la présence d'une pathologie psychiatrique a disparu. Seule reste l'analyse des facultés de comprendre et/ou de vouloir ce que la personne expertisée a fait dans la détermination de l'irresponsabilité ou de la responsabilité restreinte, ce qui est sémantiquement très proche des concepts de discernement (comprendre) et de contrôle (vouloir).
Force est de constater que la souplesse de la loi, qui permet à l'expert d'utiliser comme il le souhaite, de la façon la plus large, ses propres orientations cliniques, n'a pas effacé, tant s'en faut, les difficultés de jugement qui découlent de l'appréciation par des humains de la relation d'un autre humain à son geste criminel.
L'appréciation au final de la responsabilité comme une entité indépendante d'un éventuel syndrome pathologique n'empêche pas certains experts de se couler dans un moule plus proche de la « common law » que des traditions des pays latins ou du Saint Empire romain germanique, qui eux sont orientés l'irresponsabilité pénale, et même si le code ne dit pas qu'en étant schizophrène ou paranoïaque, on est irresponsable, il y a pour eux une relation de cause à effet constante qui les amène à dire que le patient est schizophrène DONC irresponsable, alors que pour les seconds, la psychose, même délirante, ne prive pas forcément le malade mental de la capacité de délibérer avec lui-même par rapport à un geste dont il peut dont il peut avoir parfaitement conscience du caractère de transgression, ce qui pourrait conduire à un acte précisément délibéré dont on ne voit pas pourquoi la maladie ôterait la responsabilité pénale.
Le temps n'est plus où, sous l'influence d'une certaine sociologie américaine et d'une certaine psychanalyse en France, étaient prônés le jugement pour tous et le renvoi systématique de l'auteur de crime devant la juridiction populaire, le psychiatre n'étant pas réputé plus fondé que le jury à déterminer la responsabilité et la comparution étant par elle-même parée d'une vertu thérapeutique restaurant au fou sa qualité d'homme via sa responsabilité. Mais l'instauration par la loi de février 2008 sur l'irresponsabilité pénale d'une forme de procès où peut comparaître l'auteur devant les parties civiles n'en est pas loin. N'en déplaise à ces récusateurs de la fonction d'expert, il existe quand même une strate clinique dans la notion de discernement qu'il appartient bien au psychiatre d'évaluer, ne serait-ce qu'en termes de capacité cognitive.
Pourtant, précisément, l'évaluation cognitive ne peut se fonder que sur la comparaison d'un jugement et d'un sens commun à l'évaluateur et à l'auteur du crime. N'est pas incriminable celui qui « ne sait pas ce qu'il fait » car dépourvu comme un enfant du sens du bien et du mal. Cette référence au fonctionnement infantile et à un absolu de la perception du bien et du mal est justement ce qui est jugé par les opposants à l'expertise psychiatrique comme une forfanterie grandiose du psychiatre et disqualifiante de l'humanité de l'auteur.
Mais la question clinique se complique encore deux possibilités : celle de distinguer ou non comme signifiants de ses capacités le fond et la forme du discours de l'auteur, et celle de prendre en compte, même en prétendant le contraire, une dimension morale par rapport au geste lui-même et surtout par rapport à la volonté de l'auteur, même si cette volonté est sous-tendue par une fausseté du jugement.
Un des éléments essentiels également de la prise en compte de critères moraux plus ou moins affublés de justificatifs cliniques va être l'existence ou non de bénéfices de réalité : pour être psychiatre, on n'en est pas moins homme et il est difficile d'accepter que le crime profite, même à un fou, avec la simple « sanction » thérapeutique ! Il conviendrait pour le « psychiatriquement correct » dans le cadre judiciaire, que l'auteur ait au moins la décence de n'avoir pas agi dans le sens de ses intérêts. Or, il s'agit évidemment d'une contre-vérité clinique : pas plus qu'on ne peut exiger du schizophrène pour le juger fou qu'il tente de boire par l'oreille ou porte un entonnoir sur sa tête, on ne peut exiger que son crime soit sinon gratuit, au moins sans but ni résultat concrètement favorable à son auteur !
Il y aurait donc souvent de « bons » criminels qui ont le bon goût de rester dans une logique folle jusqu'au bout, et des « mauvais » criminels psychotiques qui ont le culot d'avoir agi pour leur bien dans la logique commune et qu'il conviendra de confronter à la loi au travers des conséquences de leur acte !
La capacité d'ailleurs à prendre en compte les conséquences de son acte devient un des éléments à discuter pour la question du pronostic : étymologiquement, le mot « responsabilité » est issu de la racine indo-européenne spons qui, partant des libations en désignant à la fois le cratère et les versets adressés aux Dieux, conduit à la fidélité (spouse en anglais !) et au contrat, introduisant de fait les conséquences de l'action dans le terme même de la responsabilité qui comprend donc non seulement la capacité d'agir en pleine connaissance de ce qu'on fait, mais aussi la capacité de prévoir les conséquences de son acte. On employait autrefois l'adjectif « inconséquent » pour les immatures de tous poils, pervers ou candides, qui étaient défaillants de ce point de vue ! On peut remarquer que pour certaines théories neuroscientifiques actuelles, le remue-ménage synaptique de l'adolescence, qui reprend d'arrière en avant l'essentiel des connexions de l'enfance entre 11 et 23 ans, aboutit non seulement à une défaillance des jugements moraux par les lobes préfrontaux du cerveau susceptibles de corriger des visions plus élémentaires des structures sous corticales, mais aussi (peut-être...) à l'incapacité de réellement prendre en compte les conséquences de ses actes jusqu'à cet âge d'entrée dans la maturité neurologique. Ceci a servi d'argument à ceux qui voulaient, aux États-Unis, interdire au niveau fédéral l'exécution capitale de mineurs malgré la tendance actuelle à considérer comme les romains que la « malignité l'emporte sur la puérilité ».
Or, ces conséquences peuvent évidemment être catastrophiques au sens mathématique, sans rapport avec le désir du sujet dans l'action, élément derrière lequel se retranchent bien souvent les immatures auxquels nous sommes confrontés dans les expertises et plus tard dans leur prise en charge. Ces immatures, psychotiques ou non, souvent a-structurés et très proches d'un monde de représentations et pulsions sans associations mentales, même si leurs habiletés sociales acquises peuvent faire illusion, veulent bien assumer la responsabilité de leurs intentions mais non des effets de leurs actes accomplis !
Peut-on encore dire qu'il n'y a pas d'altération du discernement chez quelqu'un qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez et ne voit pas que son geste de vengeance ou d'agression va entraîner la mort alors qu'il voulait seulement lui-même se faire entendre ou blesser son adversaire dans sa dignité ou son corps ? À l'inverse, faut-il prendre comme une altération, voire abolition du contrôle de l'acte du criminel, le fait que sa maladie le prive des capacités de réalisation d'un désir pourtant exprimé ? L'incendiaire incapable de faire partir son feu malgré son papier et ses allumettes est-il moins dans la volonté de transgresser que celui qui est dépassé par le sinistre qu'il a allumé, mais aurait voulu circonscrit ? Il est évident que les psychiatres, selon leurs propres positions personnelles, décriront « le verre à moitié plein ou à moitié vide », à partir de la même capacité décrite par la clinique !
Ainsi, le paranoïaque qui raisonne juste avec des prémisses fausses conserve son intelligence et va parfois livrer à la cour qu'il a longuement hésité avant d'agir dans un douloureux dilemme, ayant conscience que ce que lui commandait sa raison de façon impérieuse était interdit par la loi. Se résolvant au passage à l'acte, ce paranoïaque peut expliquer qu'il s'est sacrifié oblativement acceptant de payer sa transgression pour l'intérêt supérieur conçu dans son délire (sauver le monde ?). Ce type de délire sera le plus souvent évalué sous la forme d'une altération du discernement, à condition que, comme on l'a vu, le passage à l'acte n'ait pas pour fonction de « rapporter » audit paranoïaque qui en tirerait un bénéfice même inconscient ! À l'inverse, un schizophrène qui ose se défendre de façon plus ou moins cohérente, après un acte absurde issu de sa logique délirante, ou ayant dérivé une pulsion dans un passage à l'acte sans pouvoir la relier à quoi que ce soit en lui, même à un état émotionnel, s'il va dans le sens de ses intérêts, avec quelques éléments pertinents, réfutant par exemple des preuves policières ou avançant un alibi, verra comptabiliser cette tentative de sauvegarde de son intégrité psychique comme une marque de perversion ou de cynisme nécessitant impérativement d'être confronté à la loi !
Cette notion va dériver aussi dans l'appréciation du pronostic par l'examen par les psychiatres du déni opposé à la dénégation. Fans une extension contestable de l'acception générale de ces termes ou de leur sens particulier en psychanalyse, certains experts opposent le déni de la réalité, défense psychotique qui permet de nier son acte parce que dans l'économie psychique on ne peut pas lui faire place dans la tentative d'ordonner son monde intérieur, par opposition à la dénégation qui, plutôt que le fait de nier la composante pulsionnelle refusée d'un acte (« n'allez pas croire que j'ai agi par jalousie ! ») est ramenée plus prosaïquement à une négation consciente utilitaire et pour tout dire un mensonge, appelant à la reconnaissance du discernement et à l'orientation vers la responsabilité pénale.
Au-delà de l'appréciation de la responsabilité dans les expertises pré-sentencielles, la dialectique de l'appréciation clinique du déni ou de la dénégation va orienter clairement l'avis de beaucoup d'experts quant au pronostic et à la curabilité de l'auteur, au mépris de la réalité clinique, la dénégation pouvant fort bien s'accompagner dans l'après-coup d'un tel rejet de l'acte commis qu'il n'y a aucune chance de récidive !
Quant à la capacité de se contrôler dans le passage à l'acte, cette appréciation est aussi fonction de ce qui, pour le psychiatre, réalise un état émotionnel incoercible. On retrouve ici la nouvelle notion de trouble coercitif introduite dans la cascade de paraphilies du DSM-51 si critiqué qui laisserait entendre qu'un violeur en série est « catégoriquement » soumis à sa pulsion contre laquelle il ne pourrait rien ! Cet état aveugle-t-il l'auteur jusqu'à ce qu'il soit incapable de se retenir ou l'auteur a-t-il au contraire joui de se laisser aller, ce qui doit lui valoir les foudres de la justice, même si cette jouissance s'inscrivait dans une logique folle. La décomposition alors dans l'action de ce qui relève du discernement et de ce qui relève du contrôle n'est pas toujours aisée : si un schizophrène dit qu'il a répété son geste criminel parce qu'il a constaté que le premier passage à l'acte l'avait régénéré, s'agit-il d'un trouble du discernement ou d'un trouble du contrôle ?... Et si sa responsabilité pénale était abolie pour le premier passage à l'acte, l'était-elle pour les suivants ?
On se heurte parfois à l'illusion d'indépendance des juges et des experts avec tous les biais qui sont bien connus quand on cherche la redondance pour éviter les pannes aléatoires dans l'industrie, par exemple en faisant concevoir et construire les ordinateurs des avions par deux équipes différentes qui s'ignorent alors que mettre deux calculateurs identiques est une fausse redondance qui n'éviterait pas une panne « conceptuelle ». Multiplier les collèges d'experts choisis par le même juge de même affinité intellectuelle peut inconsciemment se réduire à chercher à conforter le résultat qu'on attend. Au total, il n'y a pas d'unanimité chez les psychiatres pour définir ce qui cliniquement engendre la capacité ou l'altération du discernement, la capacité ou l'altération du contrôle de son acte délictueux, ce qui n'est pas pour autant l'invalidation de l'expertise si l'expert a la modestie d'assumer sa subjectivité en exposant en même temps que ses conclusions les critères de son jugement personnel et de sa démarche. Pour que l'expertise soit utile, il faut qu'elle renonce à déboucher sur une certitude incontournable : l'expert ne dit pas la vérité, il dit ce qu'il a entendu et ce qu'il en pense.
Notes
(1) Cinquième édition du "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" de l'Association Américaine de Psychiatrie (APA).
